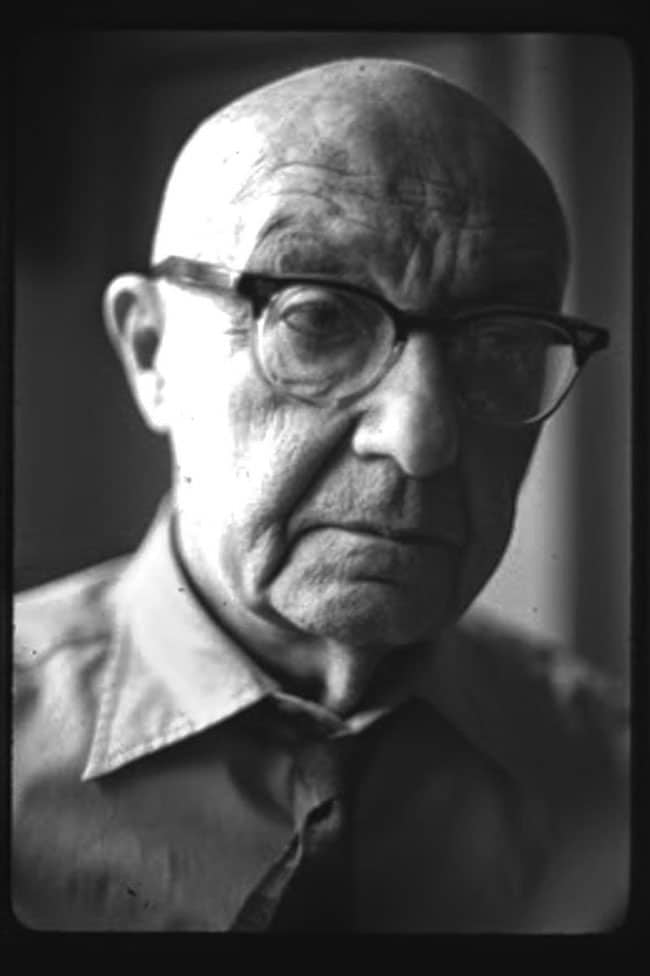Le premier numéro de La Barque dans l’arbre, qui succède aux neufs numéros de feu La Barque (2006-2012) demeure volontairement non thématique, selon le souhait de son animateur Olivier Gallon. Ce dernier s’en explique dans un entretien publié sur le site Diacritik : « il ne s’agit pas d’une revue programmatique, encore moins thématique. Elle n’est pas le fait d’un collectif, relèverait davantage d’une communauté, d’un partage. Son « imaginaire littéraire » (…) est tout entier dans l’exigence du poème, exigence n’appartenant pas qu’à lui seul ». Revue poétique donc, animée non pas par un comité de rédaction mais par une communauté d’auteurs, dont plusieurs ont été publiés par La Barque, qui est aussi une maison d’édition.

« Un des plus grands plaisirs de la vie, c’est d’y aller au culot avec quelqu’un de plus informé et armé que soi-même » confie l’écrivain américain Conrad Aiken (1889-1973) à un ami épistolier dans une lettre de juillet 1931. A la lecture de ce premier numéro de La Barque dans l’arbre, se dégage une impression de discussion amicale entre les auteurs, un fil tendu entre des individus très informés et armés par la vie, unis par la richesse de leurs expériences réciproques. On passe ainsi insensiblement d’un texte à l’autre comme on le ferait dans l’œuvre d’un unique auteur, rassemblant au sein d’un même livre des essais, poèmes, récits, fictions et lettres. Là est la magie de cette revue et de la revue en générale telle que pensée par Olivier Gallon, « lieu d’accueil par excellence » où des textes divers et variés peuvent harmonieusement cohabiter. D’une blanche sobriété, au format très agréable (pas trop épais, sans illustrations), ce premier numéro entraine notre barque dans un arbre dont la sève à venir s’avère riche et diversifiée.
L’ambiance générale de ce numéro de l’hiver 2017-2018 est bien celle de cette saison, propice au recueillement, au calme que l’on éprouve dans la réclusion volontaire. Dans son poème impressionniste au « lyrisme paysager », l’écrivain russe Arkadi Dragomochtchenko (1946-2012) nous annonce ainsi l’entrée « dans l’histoire comme dans un autre hiver », « la neige dans la fable ramifiée de la ville ». Quelques pages plus loin, un poème d’Evelyne Amoursky évoque, dans le même registre, une boule de neige et de cristal, des cristaux de neige tombant lentement sur le monde. Ambiance ouatée. L’écrivain et scénariste italien Tonio Guerra (1920-2012) nous conte son installation en montagne, par un mois de janvier : « De petits tapis de neige résistent sur la croupe de la montagne qui me reflète au-delà des fenêtres. J’ai envie de rien faire. Je regarde le feu et le chat. Je lis l’histoire d’un ascète qui garde toujours le silence. Ne pouvant sortir, je m’aperçois que la maison devient plus grande. Je m’assieds dans le petit fauteuil ou sur le divan. Parfois, j’émigre. A présent, à chaque fois que je quitte la cheminée pour la petite salle à manger, c’est un voyage. » (Il pleut sur le déluge).
La maison du chat et de l’anachorète des montagnes, lieu de recueillement et de méditation, ce peut être aussi la maison miniature pour poupées que l’écrivain contemporain Nicolas Vatimbella décrit dans sa prose féérique : « Te voilà maison à l’intérieur parfait. Tout y est à sa place, parfaitement rangé. La pelote de laine est sur la table, près de la tricoteuse. Les deux jumeaux reposent près de leur maman. La repasseuse ne brûlera pas. Comme cet ordre parfait me remplit d’aise ! Quelle plénitude que de pouvoir contempler cette vie parfaite. » (Petronella Dunois).
La saison hivernale est aussi synonyme de paix et de silence avant le retour de la vie et de ses bruits printaniers. L’écrivain américain Charles Reznikoff (1894-1976), dans un magnifique poème d’inspiration juive ; « Kaddish », du nom du rituel de la synagogue récité par les endeuillés, décrit les derniers jours de sa mère. A cette prière sous la forme de poème succèdent deux poèmes religieux d’Anna Kamienska (1920-1986) : « Le retour de Job » et « La prière de Job ». La petite notice consacrée à cette poète, écrivaine, critique littéraire et traductrice polonaise nous explique son souhait de pratiquer une poésie questionnant et rejetant la grandiloquence. Ses poèmes sur la figure biblique de Job témoignent de cette volonté par leur caractère épuré. Incarnation de la souffrance et de la solitude de l’homme, Job enseigne selon Anna Kamienska le sens du silence et le silence du sens : « le silence d’un animal malade, le silence du nuage de la pluie sur l’herbe, le silence du soir et de la nuit, le silence du bien et de la gratitude. »
C’est aussi cette quête du sens du silence que l’écrivain français Louis-René des Forêts (1916-2000) décrit dans le texte inédit, publié en ouverture de la revue. Cette quête poétique et existentielle, à l’instar de Jean Grenier, Louis-René des Forêts l’appelle « l’attrait du vide ». Elle se trouve résumée dans la question qui ouvre la revue : « Quel homme n’a pas éprouvé un jour le besoin de se mettre à la disposition de ce qui est là autour de lui pour le saisir, non comme théophanie, mais dans son immobilité souveraine, sa nature inintelligible ? ». Cet attrait du vide, ce vœu d’échapper à l’inexorable phénoménologie de la vie, au poids de la nécessité métaphysique, n’est-il pas le souhait de défier, le temps d’un éclair, les yeux de la Gorgone ? Louis-René des Forêt la caractérise par une opposition de l’individu à l’ordre imposé par le monde, par un besoin humain de se singulariser, que seul l’acte de création, in fine, permet. Le silence s’impose par conséquent aux écrivains sommés de s’exprimer sur leurs créations à la télévision et lors d’interviews, tel que nous l’explique des Forêt dans son second texte inédit, « Littérature et télévision ».
Les mots d’Olivier Gallon évoquant l’ami défunt, en clôture de ce premier numéro de La Barque dans l’arbre, résonnent en écho aux propos d’ouverture Louis-René des Forêts : « Là où l’inintelligibilité nous apparaît, elle présente un caractère scandaleux, mais c’est aussi par ce qui en nous excède les représentations de l’intelligence que nous sommes humains ».
Goulven Le Brech