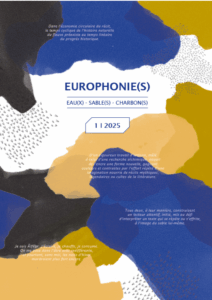
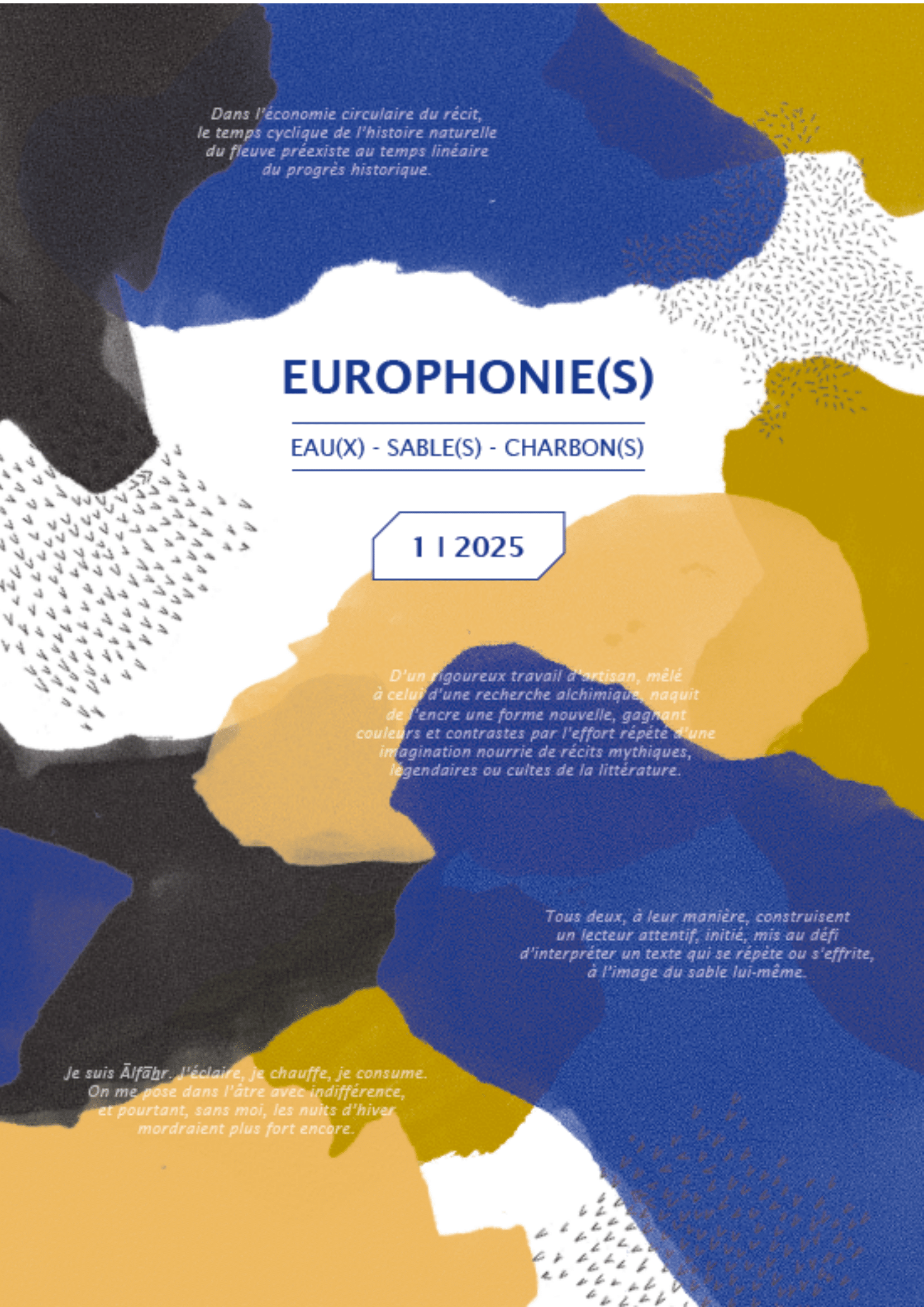
Publiée par le Cercle Européen de Recherche et de Création Littéraires (CERCL), la revue Europhonie(s) en reflète fidèlement les activités dans le triple registre scientifique (études critiques), artistique (textes de création, ateliers d’écriture) et citoyen (engagement territorial pour le « vivre ensemble »)[1]. Ce projet éditorial, refusant de séparer le « sensible » du « social », au nom du partage des connaissances, s’inscrit pleinement dans la réflexion de Bruno Latour, selon lequel : « La politique est l’art des possibles, mais il faut des arts pour ouvrir les possibles »[2].
Dans un moment où les épistémologies, les arts et les pratiques se croisent et se combinent, ce premier numéro filtre les « eaux », passe au crible les « sables » et raffine les « charbons » avec exigence pour produire un objet de qualité, passionnant à lire et beau à regarder. La conception graphique est signée Margot Nolin et annonce les couleurs écologiques du volume dès la couverture : le bleu d’« une mer qui perd les eaux « (Meryem Jaouhari), le jaune d’un sable qui gagne du terrain et génère l’oubli (Florine Lemarchand) et le noir d’un charbon, trace indélébile d’une époque révolue et empreinte désormais angoissante de la société consumériste actuelle.
Le terrain d’investigation de ces jeunes revuistes, étudiants pour la plupart, se situe dans la Nièvre, à La Machine, une ancienne bourgade minière dont la population, la plupart du temps, a oublié les peines et se plaît à évoquer « l’ancien temps » comme si le charbon avait toujours été diamant. Et leur laboratoire l’université de Clermont Auvergne qui leur apporte un fort soutien logistique et financier et à laquelle les trois doctorants-pilotes de cette aventure : Méline Zappa, Oriane Chevalier et Paolo Dias Fernandes, directeur de la publication et président de l’association, sont rattachés. Citons en particulier le Centre de Recherche sur les Littératures et la Sociopoétique, l’Ecole doctorale des Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales et la Fédération de Recherche Eaux, environnement et territoires . Un même désir les anime : promouvoir un savoir qui s’attache au tangible et ouvrir la recherche en littérature par l’art et l’action.
Les lecteurs pourront ainsi revisiter de manière « aquapoétique » la littérature antique grâce à Daphné Le Digarcher Doublet et Myriam Desrippes, démêler « la poussière du réel » du « sable magique » chez Proust avec l’aide de Clara Bardot et Graciela Villanueva, tremper leurs lèvres dans la suie, transmutée ici en « élixir de longue vie », par Thierry Cousteix, Alex Lamoure, Maxime Tanneur, Claire Demange, les lauréats 2024 du Concours d’écriture poétique « Charbon(s) », et s’aventurer dans le monde des esprits de l’Atlas avec Meryem Labrabiche. Les lunettes à chausser pour pleinement goûter ces pages ne sont pas virtuelles. Pas de machines à La Machine, mais des cœurs et des âmes réinvestissant les lieux les plus inattendus pour leur redonner une vie nouvelle.
S’ouvrant avec un texte, à la fois spéculatif et poétique, de l’anthropologue José Muchnik, ayant suivi les traces de Claude Lévi-Strauss et de Philippe Descola en Amazonie : « La maison brûle » et se refermant sur un très bel entretien mené par Oriane Chevalier avec cette immense artiste qu’est Li Chevalier, engagée depuis plusieurs décennies dans « un voyage d’exploration de la peinture à l’encre et à l’eau entre l’Asie et l’Europe », ce numéro 1 d’Europhonie(s) – après un numéro 0 très prometteur – nous redonne des raisons d’espérer dans un contexte international et national désastreux. « En dépit du mal », réaffirme l’artiste sino-française, « j’ai la conviction qu’il existe des règles de l’harmonie invariables, susceptibles de provoquer des sensations de beauté ». L’équipe du CERCL aussi sans aucun doute. C’est de cela d’abord qu’il convient de la remercier.
Valérie Deshoulières
[1] Voir à ce sujet En quête d’images. Ecritures sensibles en recherche-création, un volume collectif coordonné par Anne Bationo-Tillon, Francesca Cozzolino, Sophie Krier & Nicolas Nova (Les presses du réél, la grande collection ArTeC, 2024).
[2] Propos tenus par Bruno Latour invité par Yves Citton lors de la conférence inaugurale des Rencontres organisées par l’école universitaire de recherche ArTeC, le 20 septembre 2018.