
Le onzième numéro de la Revue Giono rassemble, comme chacune de ses livraisons, un nombre impressionnants de documents et d’études consacrés à l’oeuvre du plus célèbre des écrivains de Provence. On y retrouve un goût, une saveur, une disposition face au monde qui réveillent de grands souvenirs de lectures, comme une espèce de traversée d’une oeuvre magistrale.
Tout d’abord ce volume propose un mouvement à l’oeuvre qui va, en quelque sorte, de la variété du monde à la singularité de l’homme. On y découvre au gré des documents d’abord, puis des études longues et précises, un homme, une disposition face au monde, une ironie lucide, une distance face à l’époque, un souci d’être juste. Giono est seul et entouré, on dirait un faune qui récite de la poésie dans la montagne.

Lire ses échanges épistoliers avec Louis Brun des éditions Grasset, s’ils font sentir les tensions avec Gallimard, les petits trucs des coulisses de l’édition, les négociations d’argent (on se souvient du volume un peu délirant et très passionnant de Céline chez Folio), on reste surtout frappé par ces instants où l’écrivain découvre la puissance de ce qu’il écrit, en train, avec la façon dont un sujet, une matière s’imposent. Il écrit à Brun en 34 à propos de Que ma joie demeure : « je me trouve devant le livre de ma vie. J’ai tout pour le faire. Je peux créer une sorte de monstre glorieux et magnifique avec ses épaules formidables, du sang de fer et une bonté d’ange ».
Car ce qui compte ce ne sont pas les détails, les précisions, les arguties de spécialistes – qui sont bien souvent fort utiles on l’admettra volontiers -, mais bien ce que ces documents révèlent, ce qu’ils découvrent de l’oeuvre, de son sens, de la relation qu’elle établit, des choses humaines qui s’y dévoilent soudain. Ce sont les directions de l’oeuvre qu’il faut dégager de la masse informative, le plan dans le détail en quelque sorte. Ce volume y parvient, par éclipses. Et c’est très bien, très revigorant. Ainsi on lira, dès le commencement de leurs échanges, ce que le libraire Henri Pollès écrit à Giono au début des années 40 : « Il n’y a de vrais créateurs que les poètes comme vous. Vous, oui, vous créez un pays, un monde, des hommes : je ne dis pas que vos bergers n’existent pas, mais vous les aimez tant que vous les avez élevés à votre taille. (…) C’est vraiment la démarche épique : ce sont des hommes comme ils devraient être, c’est-à-dire des inventeurs de la vie et du monde. » Il ajoute un peu plus loin que « chacune de (ses) phrases nous enlève une taie que nous vous sur l’oeil, ou nous fait naître à un autre monde, une autre lumière. »
Et ce sont bien les rôles et de la nature et des êtres exemplaires qu’a créés Giono, leur fonction, ce qu’ils révèlent. On s’amusera au gré des lettres de quelques bons mots, de quelques cruautés qui émaillent toutes les correspondances qui valent quelque chose et nous laissons le plaisir au lecteur de les découvrir comme au détour. On sent dans ces échanges la tension lucide de l’écrivain qui travaille, beaucoup, qui se concentre, qui saisit l’état d’un monde élevé au rang mythologique. Car s’ils échangent beaucoup de listes de livres, qu’on découvre un Giono collectionneur, ce sont surtout les titres qu’il recherche qui disent quelque chose – les italiens, Machiavel en tête, Agrippa d’Aubigné ou une flopée de textes espagnols du grand siècle… On découvre un lecteur avide, sérieux, qui confie : « Vous n’imaginez pas le bonheur d’écrire sans publier. C’est l’opium le plus envoûtant. »
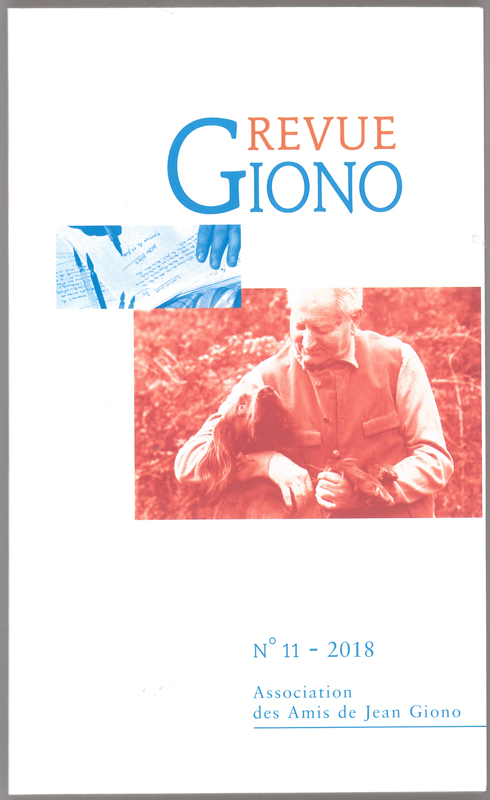
Suivent ces correspondances, les notes pour une adaptation au théâtre du Chant du monde qui convainc fort peu pour être honnête et ne recèle que peu de choses vraiment passionnantes. Puis des préfaces à certaines de ses oeuvres pour des éditions étrangères. Celle de Philippe Claudel qui parle du Grand troupeau de manière un peu convenue et qui nous dit quelque chose, selon lui, de la nature du travail de l’écrivain : « Il faut voir, nous dit Giono. Il faut regarder. La littérature sert à cela. » On passera sur la préface des Pan pour souligner la qualité enthousiaste et un peu iconoclaste d’Edmund White qui raconte sa passion pour Melville et la difficulté de le traduire. Quelques études, fort développées sur le rapport de Giono aux animaux, sur leur présence, physique et symbolique, dans ses romans. On retiendra en particulier le texte long et bien écrit d’Alain Romestaing qui relie l’animal à l’âme, grande question pour les lecteurs de l’oeuvre de Giono, de toute l’oeuvre, des textes du début qui célèbrent la nature ramenée au rang de la divinité quasi, jusqu’aux Chroniques où les hommes reprennent le premier rang. On y retrouve toujours les mêmes « lignes de force propres à cette oeuvre, entre le goût du sauvage, l’importance cruciale de la sensorialité et de la sensualité, l’inspiration panique, la conscience de la solitude et du néant de la condition humaine. »
Bref, on lit du Giono. Et ça fait un bien fou.
Hugo Pradelle