
Figures de la psychanalyse est la revue qui émane d’Espace analytique, l’association psychanalytique fondée par Maud Mannoni. Inaugurée par Joël Dor qui l’a dirigée jusqu’à sa mort, la revue a été ensuite coordonnée par des rédacteurs en chef successifs : Ignacio Garaté Martinez, Claude Boukobza, Gisèle Chaboudez, Claude Noële Pickman, Olivier Douville, puis à nouveau vous, Gisèle Chaboudez, avec Jacques Sédat. Quarante cinq numéros ont été publiés, avec une grande amplitude de champ. Ainsi ils explorent des sujets variés – de « Mélancolie et dépression » en 2001 jusque « En quoi l’inconscient est-il politique » en 2023, en passant par de nombreux enjeux comme le langage, le trauma, l’événement adolescent, le fait religieux, le symptôme etc. Chaque numéro comprend généralement trois volets : le thème du numéro qui rassemble un ensemble de textes, une section « Mélanges » qui offre un espace libre aux auteurs désireux d’écrire sur des sujets variés et un « Cabinet de lecture » qui propose des comptes rendus d’ouvrages récemment publiés, et parfois de films. Pour mieux comprendre les enjeux, les pratiques, qui portent la revue et sa manière de se faire, Dina Germanos Besson s’entretient avec sa rédactrice en chef, Gisèle Chaboudez.
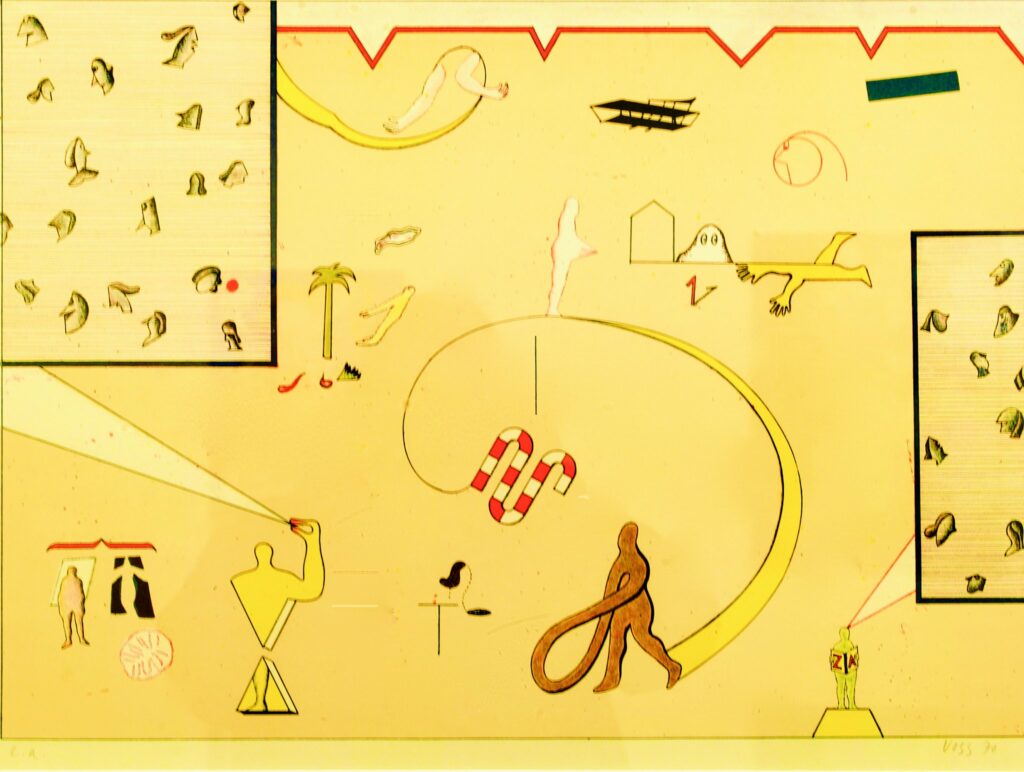
Jan Vos « Sans titre » (1936) (Centro de Arte Manuel de Brito) © CC BY 2.0/Pedro Ribeiro Simões/Flickr
Pourriez-vous nous parler de la logique qui préside au choix des thèmes de la revue ?
Pour ma part, je suis arrivée dans l’institution lorsqu’elle venait d’être créée par Maud Mannoni avec un groupe de psychanalystes qui l’avaient suivie lors de la scission du CFRP (Centre de formation et de recherches psychanalytiques). Nous avons repris la revue après la mort prématurée de Joël Dor, qui l’avait entièrement organisée jusque-là. Dans l’ensemble, les thèmes abordés sont ceux qui sont mis au travail dans les « Journées d’Espace analytique », « non pas comme actes de ces Journées, mais comme publication de leurs meilleurs travaux ». Cela permettait de retracer l’évolution de la pensée dans notre institution, tout en restant ouvert à d’autres propositions. Cette organisation a été progressivement mise au point avec les premiers rédacteurs en chef ; je l’ai reprise et développée. Elle s’est avérée à la fois souple et riche pour assurer deux publications par an : un numéro susceptible de refléter nos travaux et un autre réservé à l’exploration d’un thème choisi.
Cette revue rassemble des écrits sur la psychanalyse : les concepts de Freud, de Lacan et de quelques chercheurs anglo-saxons. Elle ménage surtout une place essentielle à la praxis, c’est-à-dire à l’expérience analytique, au « faire », comme un work in progress où l’énigme est sans cesse reconduite. Ainsi, lorsqu’on lit la revue, nous avons l’impression que l’accent est davantage mis sur le mouvement que sur le but, sur la recherche que sur le résultat. Ce qui est alors privilégié, c’est le désir de l’auteur sondant ses propres réflexions afin de faire passer ce qui est transmissible (ou plutôt ce qui ne l’est pas, poussant à l’interrogation !).
Chacun a son propre style pour transmettre ce qu’il apprend de la psychanalyse. Si en effet la psychanalyse est un work in progress, cela ne veut pas dire que son propos est de chercher pour ne pas trouver. Certes, certains travaux donnent parfois cette impression, et la plupart des travaux analytiques s’attachent à ce que l’on sait déjà, plutôt qu’à trouver du nouveau. En outre si le texte de Freud était d’un abord relativement aisé quoique complexe, et si les textes anglo saxons le sont également, on sait que le texte de Lacan a été délibérément chiffré, soutenant qu’il fallait qu’on y mette du sien. L’énigme peut alors être dans ce cas fort longtemps reconduite. Dans l’ensemble nous essayons de réunir différents types d’approche, de lecture, d’écriture, et de rassembler un certain nombre de modes distincts de désirs dans l’approche de la chose analytique. Mais il est vrai que la référence à l’expérience clinique, toujours explicitement ou implicitement présente, demeure une constante des travaux de l’institution, et donc de la revue. Nous avons tenté de surmonter de vieilles discussions, entre une clinique sans intérêt si elle n’est appuyée sur des concepts solides, et une théorie sans âme si elle ne reflète une expérience clinique authentique. Cela s’avère relativement simple, tant il y a de manières de faire sentir combien l’une habite l’autre.
Dit autrement, il n’y a de psychanalyse que réinventée ! Et si le style est si singulier, c’est parce qu’il ne vient pas de nulle part, mais de l’intime de l’analyste, c’est-à-dire de cette part restée énigmatique, d’un désir dont l’objet demeure insaisissable, d’un je-ne-sais-quoi qui ne peut être défini. Quant à votre remarque sur les écrits de Freud et de Lacan, elle souligne elle aussi la spécificité des styles. Si Freud – l’inventeur d’une méthode sans précédent – était soucieux de la transmission, des coups de force pédagogiques pour le dire avec Michel de Certeau, il s’engage pourtant dans une recherche qui se fait à mesure qu’il explore les voies de l’inconscient jusque-là insoupçonnées. Sa démarche consistera alors à reculer dès qu’une théorie tient trop bien, échappant à l’emprise totalitaire qui fige le sens ; un cheminement qui, dès qu’il va très loin, se rétracte, survivant dans son exercice même. Il ne gardera alors de cette tentation que ses bribes dispersées, ses formations inconscientes, s’intéressant aux minuties, aux détails, à ces « choses inobservées », comme autant de traces de la singularité du sujet. Quant à Lacan, il fera un retour à Freud, en accentuant la complexité de ses théories, par des voies radicalement antinarratives et antiphilosophiques. Il privilégiera le signifiant, faisant sonner ce qu’il entretient d’obscur, arrêtant la dérive du sens qui risque de boucher l’ouverture de l’inconscient.
Oui enfin, il ne faut pas trop répéter simplement que Lacan a effectué un retour à Freud, car il est problématique que ce soit souvent la seule chose qui surnage de ce qu’il a apporté, alors que très tôt et jusqu’à la fin, il a opéré un grand nombre de renversements des concepts freudiens qui changent radicalement la nature de notre approche. Ces renversements sont oubliés ou méconnus, ou bien ils ne sont pas articulés dans une démarche conceptuelle d’ensemble qui pourrait qualifier le tracé de son apport, de la deuxième grande étape de la pensée psychanalytique qu’il a construite.
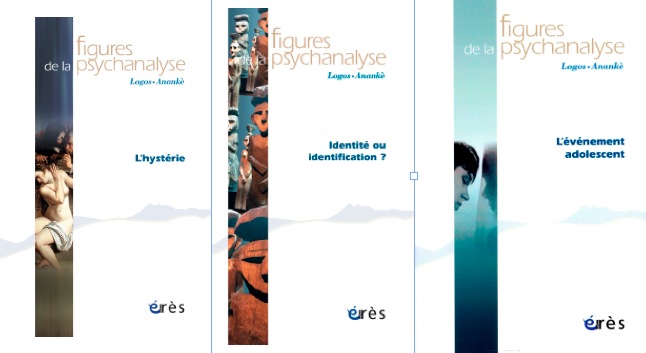
Tenant compte du réel, c’est-à-dire ce qui échappe au langage, le choix adopté par la revue est alors plus éthique qu’esthétique. Ne s’accorde-t-il pas avec celle de la psychanalyse qui, en élevant l’inconscient à sa dimension créatrice, se sépare de la psychothérapie ? Contrairement aux psychologies descriptives qui promettent la guérison, l’adaptation et l’éradication du symptôme, la psychanalyse s’intéresse au mystère de l’inconscient, à ce qui fait butée, et qui est moins un aveu d’échec qu’une expression de la résistance. Car c’est cet inanalysable, ce reste réfractaire à tout concept, qui confère au sujet sa dimension singulière, scellant son caractère rebelle. Cette idée se lit à travers les titres des numéros, dont les airs poétiques – « Art de la cure », « L’inconnue de la sublimation » ou encore « Passion de la métaphore » – objectent d’emblée à une vision scientiste.
Toute approche sérieuse de la chose analytique comporte une dimension éthique bien sûr. Mais elle ne consiste pas à opposer le mystère de l’inconscient et la guérison. S’il n’y avait pas de guérison effective possible en psychanalyse, dont nombre d’analystes peuvent témoigner, qu’ils pourraient même chiffrer si cela était nécessaire, je doute fort qu’elle garderait une telle importance. Elle a aujourd’hui, on le sait, à faire face à un recul massif de son audience universitaire et médiatique mais non de son audience thérapeutique, si l’on peut dire. Et son efficace propre en passe par le mystère de l’inconscient, même s’il n’y suffit pas. Ce reste réfractaire à tout concept appelle des concepts nouveaux, et les trouve parfois, pour peu qu’on déchiffre ce qui ne l’est pas encore. La psychanalyse n’est en effet pas une science, mais elle a avec elle en commun de produire des étapes successives de savoir, chacune corrigeant certains concepts de la précédente, comme Lacan l’a fait avec Freud, sans que ce soit encore véritablement transmis à une large échelle. Il n’en reste pas moins que ce souci de rigueur ne nous éloigne pas du processus poétique, nous en rapproche plutôt, tant il est lui-même à l’œuvre dans l’inconscient, la concaténation de signifiants comportant souvent cet effet, avec parfois celui du rire.
Freud crée sa discipline en récupérant les rebuts dont la science s’est débarrassée pour constituer sa rigueur : acte manqué, rêve, lapsus, et modalités de rire, allant du mot d’esprit à l’humour. Ce sont les saillies et les dires qui se dérobent sans qu’on s’en doute. Loin de se réduire à de simples modalités, ils s’érigent à une insurrection du langage, nécessité impérieuse pour la survie du sujet, désacralisant, renversant, allégeant l’angoisse et toute forme de despotisme. Ainsi, peut-on percevoir, à travers les ratés de la parole courante, les ruptures de sens, la dysharmonie et le rire, comment le sujet fait offense à la langue commune, l’empêchant de se dissoudre dans la masse.
La dimension politique de l’inconscient n’est pas encore une avancée lacanienne suffisamment connue, déchiffrée, et bien sûr utilisée et prolongée. Les psychanalystes jusqu’à cette phrase de Lacan, « L’inconscient c’est la politique », ont formulé une pensée du sexe fondée sur l’inconscient sans se référer à la politique, au nom de la neutralité. Les discours féministes et les études de genre ont formulé la leur en se fondant sur la politique sans tenir compte de l’inconscient. Pour ma part, j’ai adopté la démarche lacanienne qui consiste à se référer aux deux à la fois, pour saisir et peser leur équivalence en certains points, ce qui les rend relativement inséparables. La plupart des renversements que Lacan a opérés par rapport à l’étape freudienne sont de cette ampleur.
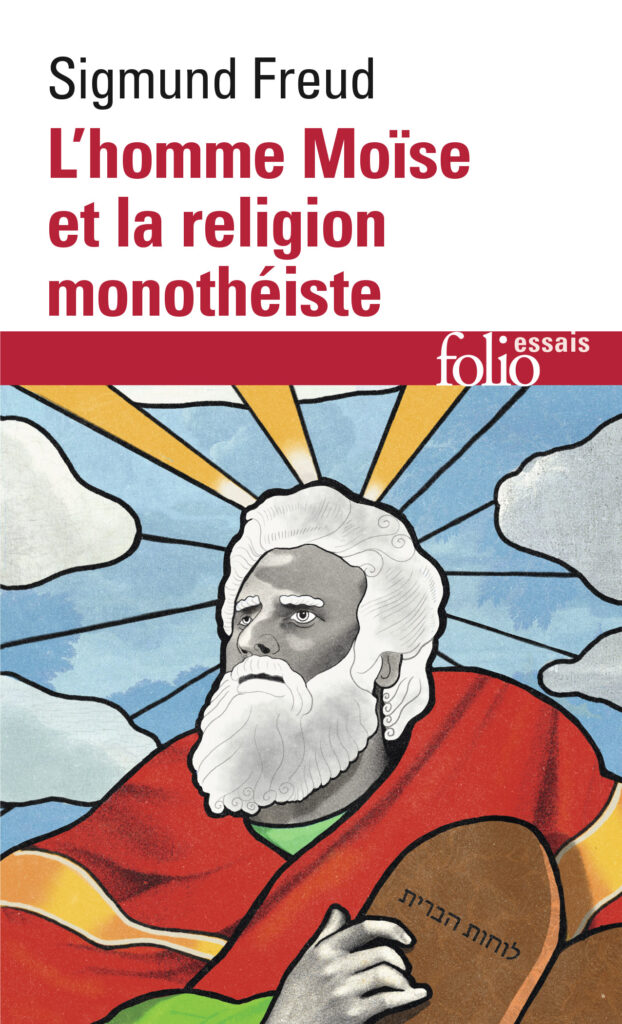 En fin de vie, Freud dégagera l’intuition d’un lien poétique, une pensée qui traverse son Moïse[1], comme en témoigne cette précieuse remarque : « On irait presque jusqu’à dire que plus une tradition est devenue imprécise, plus elle devient utilisable pour le poète. »
En fin de vie, Freud dégagera l’intuition d’un lien poétique, une pensée qui traverse son Moïse[1], comme en témoigne cette précieuse remarque : « On irait presque jusqu’à dire que plus une tradition est devenue imprécise, plus elle devient utilisable pour le poète. »
La dimension poétique est ainsi suggérée par le titre de la revue Figures. Car une figure n’a justement pas de forme fixe. Elle place le lecteur dans un certain état de langage qui risque le glissement de sens, les accidents, les équivoques, faisant vaciller les certitudes. Elle se rapproche de cette Figure dont parle Deleuze, qui surgit d’une fente, lieu d’un bruissement de deux temps où l’un n’est déjà plus et l’autre pas encore, à l’image de l’irruption involontaire de Combray dans une tasse de thé. Elle rappelle également la Figure baudelairienne qui, dès qu’elle surgit et trône, s’évanouit, à l’instar d’une passante déjouant les ruses du regardeur qui ne perçoit les charmes fugitifs que de biais, ou le temps d’un éclair. C’est un Witz !
Quel sens conférez-vous à ce titre : Figures de la psychanalyse, et surtout au sous-titre Logos Anankè ?
Le sous-titre Logos Anankè était le titre qu’avait choisi Joël Dor pour la revue, et nous ne connaissons pas vraiment le sens que cela avait pour lui. Lorsque nous l’avons reprise, nous avons souhaité un titre plus simple, une donnée plus immédiate et moins savante, et effectivement, vous avez raison, il est à la fois plus poétique et plus vague, laissant indéterminés les accents que nous pourrions y privilégier. C’est un mot qui se penche suffisamment du côté symbolique et imaginaire pour y accueillir le poème, mais aussi qui possède la rugosité du réel et de toutes sortes d’évanouissements possibles, il est immense non par sa grandeur mais par son empan.
Propos recueillis par Dina Germanos Besson, psychanalyste.
Il est également repris dans La Revue des revues no 73
[1]Sigmund Freud, L’homme Moise et la religion monothéiste, Paris, Points-Seuil, 2012, p. 177.