

Êtes-vous plutôt de tendance Robho (1967-1971) ou Macula (1976-1979) ?
Au fond, sous ces deux noms de revues d’histoire de l’art pour la première dirigée par Julien Blaine et Jean Clay et, pour la seconde, par le même Jean Clay et Yve-Alain Bois se sont développées deux manières de réfléchir les pratiques et enjeux artistiques, en mettant entre parenthèses le registre psychologique et biographique. L’époque a indéniablement changé.
Plonger dans la lecture de ces quelque cinq cent pages remarquablement présentées par un des artisans de cette histoire (Yve-Alain Bois) et se concluant sur un éclairant entretien de 2014 où Thierry Davila, en compagnie de Valérie Mavridorakis, redonnent la parole à Jean Clay, revient à traverser les questions théoriques majeures soulevées par l’histoire de l’art avant 68 et jusqu’au seuil des années 80. Depuis lors, s’est-il passé quelque chose de radicalement nouveau dans la pensée de l’art en France ? Oui, sans doute, avec l’introduction des perspectives féministes. Mais laissons cette délicate interrogation en suspens et revenons plutôt sur quelques traits caractéristiques de nos deux revues à travers les textes si stimulants de Jean Clay.
En lisant les articles qu’il consacre à Takis, Soto, Hans Haacke, Josef Albers, Lygia Clark, Vantongerloo, etc. durant les années Robho, le ton adopté frappe immédiatement. Clay ne prend pas de gants. Un exemple : « Un matin Hartung épouvanté s’aperçut qu’il avait deux mille suiveurs. » Et dans un article intitulé, sans plus de précaution, Contre l’artiste inoffensif : « Au Brésil, le Pop anti-yankee réalisé par des artistes d’extrême gauche n’est acheté que par ceux-là mêmes qu’il insulte. »
Yve-Alain Bois le souligne dans sa préface : la pensée acerbe des situationnistes (Debord et Vaneigem notamment) pointant les ressorts subtiles de la marchandisation intégrale de la vie travaille en profondeur le discours du critique, qui défend la dissolution du concept d’art dans la réalité quotidienne, autrement dit, ce que Lygia Clark désigne comme le « vivantiel ». La fonction de l’art le plus aigu n’est en aucun cas de faciliter l’acceptation d’un monde invivable, mais plutôt de contribuer à son rapide dynamitage. Faites disparaître le décor. Concrètement : sortez du musée !
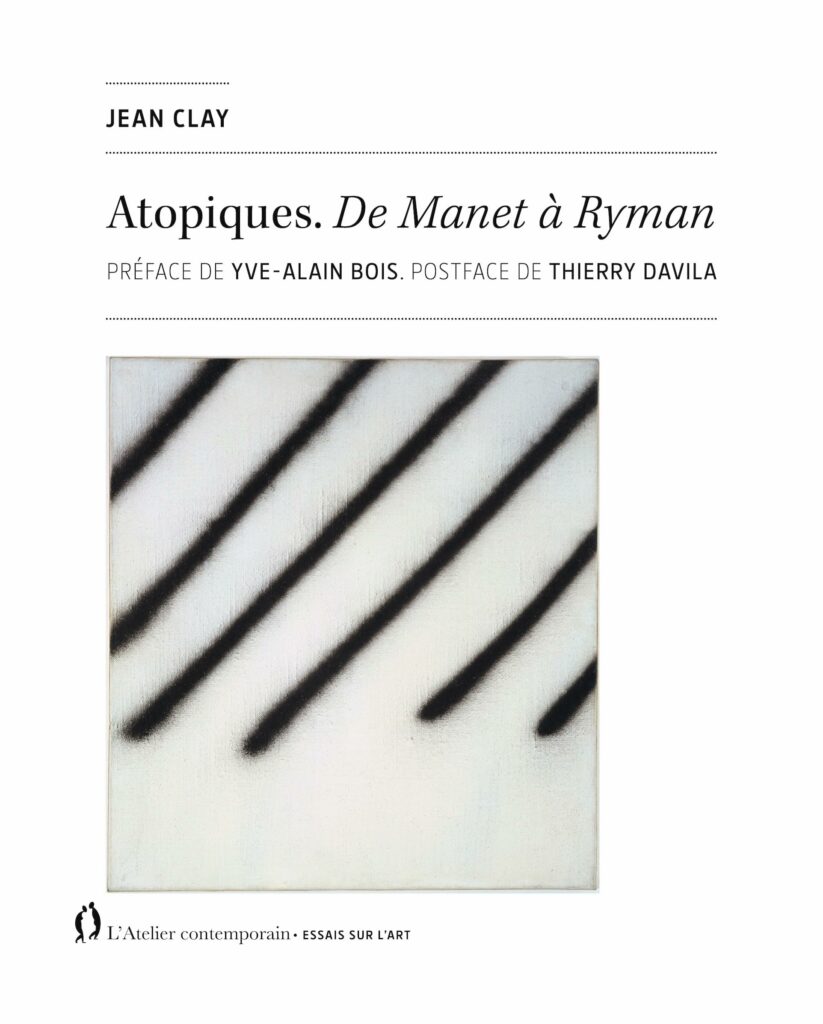
En bon pédagogue, Clay précise les étapes de ce processus : après « l’art comme métaphysique », suprême combat contre le temps et la mort (entendez-vous la voix de Malraux ou d’Élie Faure ?), après « l’art comme lecture du réel » mis à jour par les brillantes exégèses de Panofsky ou de Francastel pour qui l’œuvre traduit une vision du monde, voici venu le temps de « l’art praxis » mêlant le culturel au social. Avec la fin de la religion de l’art, la place est vacante pour le devenir politique de l’art. Il s’agit de penser Mondrian avec Marx, ce qui implique de porter le fer de la critique au cœur des institutions artistiques. Pourquoi ? « L’art n’est pas un loisir, c’est un moteur de la civilisation. », assène Jean Clay. La réponse est devenue tellement intempestive qu’on s’excuserait presque de citer pareil propos. Mais, en 1967, une telle formule pouvait s’écrire, sans scrupule, dans une revue au fonctionnement militant (i.e. personne n’était payé) et qui se vendait plutôt bien avec un tirage à 1500 exemplaires. Que s’est-il passé pour qu’aujourd’hui, on se sente désormais obligé d’argumenter longuement pour défendre la même idée ou, pire, admettre, fatigué, qu’il n’est plus même possible d’y croire. Ne pensons pas un instant que les artistes n’y sont pour rien. Ce serait oublier un peu rapidement le pouvoir de « l’os ». Notre critique nous le rappelle sans ménager les intéressés : « (…) le dressage des milieux culturels est tel que le système n’a plus rien à craindre. Qu’il jette un os, l’artiste rapporte. »
Et Yve-Alain Bois rappelle que le passage de Rohbo à Macula coïncide avec la fin d’une croyance en un pouvoir de la praxis artistique : « À présent le fait est assumé que si l’on vit, c’est dans l’empire des signes. » Ainsi, avec Macula, le dialogue se construit en compagnie du meilleur structuralisme (Barthes et Foucault) ou de son dépassement (Derrida) et d’une manière encore plus directe au regard des enjeux théoriques de l’histoire de l’art, à l’occasion du séminaire tenu par Hubert Damisch à l’École des hautes études en sciences sociales. À ces apports philosophiques essentiels, il faut aussi ajouter toutes les interactions avec les praticiens de la peinture eux-mêmes. Les discussions avec Christian Bonnefoi et le souvent mutique Martin Barré ont compté pour questionner à nouveaux frais non plus les institutions sociales, mais ceux et celles qui s’attaquaient au tableau lui-même avec ses éléments constitutifs, comme par exemple Ryman.
Au commencement, il y a le mur : c’est cela que refait horizontalement Pollock dans son atelier. N’est-ce pas aussi à ce mur originaire que Martin Barré « arrache » (selon ses propres mots) ses tableaux ? La manière Macula d’interroger la peinture ne désigne plus une FIN de l’art. Le discours formaliste s’ouvre en multipliant les points de vue. Il s’agit désormais de circuler à travers les strates de signes que les tableaux nous donnent à voir et penser. Cette façon de regarder dans diverses directions trouve en Manet un véritable maître et initiateur. L’anthologie Atopiques s’achève d’ailleurs sur l’inspirant essai intitulé « Onguents, fards, pollens » qui débute par ces mots donnant à coup sûr l’envie de poursuivre : « Manet n’a pas de style, il les a tous. »
De Robho à Macula (qui deviendra une maison d’édition), Jean Clay a lui aussi varié dans son style au beau milieu des années 70. Il ne s’agit pas d’un complet renoncement, mais plutôt d’un déplacement, comme ceux qui se trament dans les rêves, exigeant une vigilance renouvelée pour entrer dans l’interprétation du jeu passionnément complexe d’une œuvre d’art.
Jérôme Duwa
Jean Clay, Atopiques. De Manet à Ryman. Préface d’Yve-Alain Bois. Postface de Thierry Davila. L’atelier contemporain, « essais sur l’art », 2024, 496 p., 30 €