
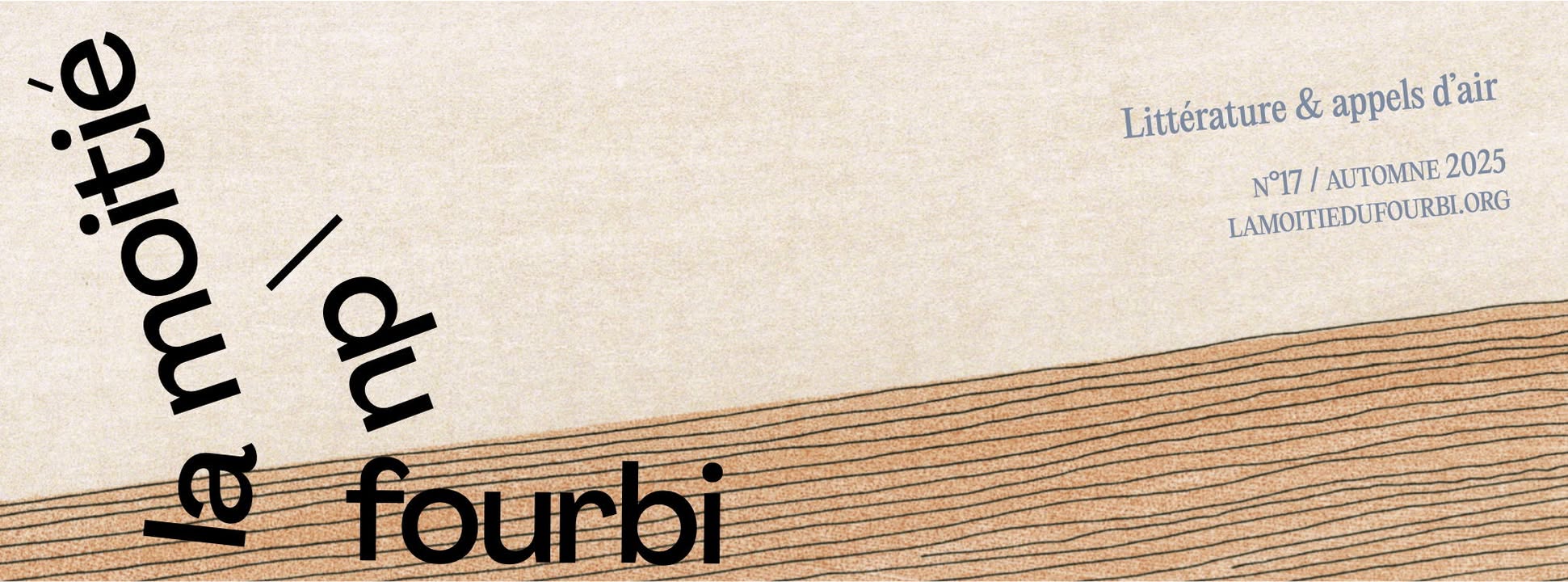
À quoi bon bricoler une revue ? À quoi ça sert donc de rassembler des textes ? Et pire des écrivains ? Ou non, des auteurs, dit-on. Pourquoi s’enquiquiner à les convaincre ? S’escagasser à relire, corriger, mettre en page, trouver des illustrateurs ? Écrivains, intellectuels, photographes, dessinateurs, bédéistes… Toute une faune qu’il faut dénicher et apprivoiser. Pourquoi donc s’obstiner à faire coexister des machins, oups, non, des textes, hétérogènes ? Et puis, sous quel prétexte ? Et puis après, pourquoi en faire un autre, de numéro ? Et puis encore un ? Avec obstination, envie, désir, folie, inconscience…
Parce qu’on est une bande et qu’on apprécie de s’agglutiner pour fabriquer un peu de beau ou de malin ? Parce qu’on se sent utile, un peu ? Ou bien juste par plaisir, jouissance même, d’écrire ensemble ? Pour offrir accueil ou trouver refuge pour des voix ? Ou bien encore, en pensant un peu à l’envers, serait-ce qu’on a peur de l’arrêt ? de la chute ? du suspens ? de la disparition. Bref, du vide ? Et bien un peu de toutes ses raisons… et dans des proportions qui varient. Faisons l’hypothèse de cette inquiétude ou de la lutte contre qui anime souvent les revuistes, petits résistants obstinés des marges ! Alors on trouve un nouveau sujet ! Et bien, ce sera – après « Trahir », « Vite », « Visage », « Rouge »… et douze autres… (ce n’est pas rien tout de même !) – : « Chutes ».
Si on pense illico à Joyce Carols Oates… Cela n’a rien à voir. Enfin, un peu aussi, peut-être. Car la revue organise une capillarité, des relations entre des textes, des formes, des langages, des idées. Une organisation de variantes qui s’approprient le mot (l’idée, la tournure…), ce qu’il fait surgir en nous comme désir de représentations. Oui, il semble bien que ce soit ce qui anime l’équipe de la moitié du fourbi. Chercher, trouver, proposer, articuler, des interventions qui déplient (déploient ?) les sens possibles que trouve le thème (sujet ?) pour des écrivains en tous genres.
 Alors, ça part tous azimuts ! Et quelle joie, quel plaisir, quel enthousiasme ! Car, il faut le dire nettement, ce 17e opus frappe fort, juste. On y retrouve toute l’habileté de l’équipe qu’anime infatigablement Frédéric Fiolof, ce sens du détour, de l’écart, de ce sérieux pas sérieux, de ce sérieux qui ne se prend pas au sérieux. On y baguenaude dans des archives et aux temples de Siem Reap, on y fouille des mémoires familiales et y éclaire les théories scientifiques, on y cause largeur d’escaliers et cryptomonnaies, on y débat fabrique de fiction, photographie et Wabi-sabi, on y brasse des questions sociales, politiques, littéraires, esthétiques, des grands enjeux de narratologie et puis, aussi, comme ça, on dérive dans des archives, on y compose des textes hybrides…
Alors, ça part tous azimuts ! Et quelle joie, quel plaisir, quel enthousiasme ! Car, il faut le dire nettement, ce 17e opus frappe fort, juste. On y retrouve toute l’habileté de l’équipe qu’anime infatigablement Frédéric Fiolof, ce sens du détour, de l’écart, de ce sérieux pas sérieux, de ce sérieux qui ne se prend pas au sérieux. On y baguenaude dans des archives et aux temples de Siem Reap, on y fouille des mémoires familiales et y éclaire les théories scientifiques, on y cause largeur d’escaliers et cryptomonnaies, on y débat fabrique de fiction, photographie et Wabi-sabi, on y brasse des questions sociales, politiques, littéraires, esthétiques, des grands enjeux de narratologie et puis, aussi, comme ça, on dérive dans des archives, on y compose des textes hybrides…
Bref on y célèbre l’hétéroclite ! C’est ça le grand fourbi à demi de la moitié du fourbi. Ce goût fantasque, fantaisiste, pour le divers, le bizarre et l’étrange. Ce qui sourd en dessous du réel, derrière le voile des évidences, qui se loge dans les plis de la langue ou de la fiction… C’est ce qu’on a sur le bout de la langue et qui démange délicieusement… Alors à partir de ce qui vient à l’esprit en se disant « chutes » on construit un numéro qui explore une multitude de pistes et qui fait entendre des voix… Celles familières de Zoé Balthus, Hugues Leroy, Hélène Gaudy, Anthony Poiraudeau ou Noëlle Rollet… Celles aussi de Philippe Artières, Olivia Rosenthal, Adrien Genoudet ou Laure Samama… C’est que le fourbi est fidèle et curieux… Qu’il garde son pré carré et ouvre les fenêtres tout en grand !
Oui, la revue ordonne une communauté libre, une sorte de confrérie joyeuse, enthousiasmante. Comment ne pas être séduit par le décalage de « Gravité » de Noëlle Rollet qui avertit, entre anecdote intime et fantaisie autour de d’Épicure ou de Lucrèce, que : « Rien n’est trop grand pour tomber, au contraire. Qui que vous soye, quoi que vous ayez fait et quoi que vous fassiez, à quelque moment que ce soit : la prochaine étape c’est la chute. / Rideau. » ? Comment résister à l’humour fantasque du « Savon dialectique », à l’étonnant dialogue entre Hélène Gaudy et son père dans « Fuites perpendiculaires » ou à la découverte de la fabrique romanesque d’Olivia Rosenthal ? On apprend, on joue, on se joue de soi. On est, comme ses personnages, « tout le temps au bord de la chute », des survivants. On envisage à chaque page une manière de chuter, de changer, de basculer, de tourner sur soi-même. De gagner ou de perdre, de continuer ou d’arrêter, d’ouvrir ou de fermer, de vivre ou de mourir…
C’est une sorte d’expérience perturbante. Enivrante et vertigineuse. Alors, o se convaincra, sans mal aucun, qu’il fait du bien de fréquenter les joyeux drilles de cette moitié du fourbi qui ne cesse de surprendre, de faire croire à de belles aventures, à des mots qui réparent, à des amusements lucides et confraternels. Oui, on lira ce superbe numéro avec joie, emportement, énergie, comme on applaudit à tout rompre !
Hugo Pradelle