
Pour Patrizia Lombardo, Critique est à la fois une aventure intellectuelle qui la relie aux penseurs qu’elle admire – Barthes au premier rang -, mais c’est aussi le lieu « de grandes amitiés éternelles — de l’intellect et du cœur », de relations qui proviennent de la pensée et la nourrissent en même temps.
Critique Memories #2
Critique : une revue, un personnage
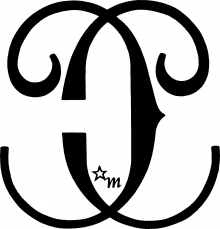
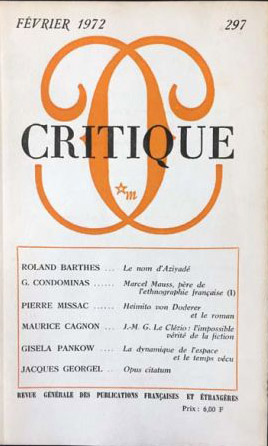
En février 1972, à Oxford où je passais une année d’études, je tombai sur un numéro de Critique à la bibliothèque de la Maison française : le premier article, « Le nom d’Aziyadé », était signé par Roland Barthes, pour lequel j’avais déjà une vénération absolue. Je ne savais pas qu’un peu plus de deux ans plus tard, je participerais à son séminaire, enivrée de vie parisienne : les conférences, les revues, les bibliothèques, les librairies, dont Shakespeare and Company, les salles de cinéma, les cafés, les rencontres avec des jeunes gens de ma génération — des étrangers comme moi, venus de partout dans le monde, et des Français, souvent formés dans les institutions prestigieuses de Paris, qui pour moi marquaient une continuité historique avec le siècle de Taine. Quelle fête de l’intelligence, quelle fièvre de vie, quelle différence par rapport à mon existence d’étudiante à Venise ! Car le bonheur et l’intérêt ont de multiples visages, comme les lieux de notre existence, les personnes auxquelles nous devons beaucoup, et les passions qui nous ont accompagnés un moment ou de manière plus durable. Mes années à Paris m’ont offert de grandes amitiés éternelles — de l’intellect et du cœur —, et parfois l’on ne peut pas faire la différence entre les personnes et les livres, surtout lorsqu’on a la chance de côtoyer des êtres qui sont les auteurs d’œuvres admirables. Il en fut ainsi pour moi de la revue Critique et non seulement de quelques-uns de ses collaborateurs, mais aussi de son directeur, à la suite de Georges Bataille et avant mon ami, Philippe Roger.
*
Jean Piel : je n’ai qu’un souvenir vague de la circonstance publique où un ami me présenta à lui. Quelle émotion ! Moi, parler à cet éditeur formidable qui avait lancé tant de noms dont l’influence reste forte aujourd’hui ! Je le vois : grand, debout, appuyé à sa canne, avec son sourire ironique et parfois sarcastique. Plus âgé que Barthes, il représentait encore pour moi l’éthos surréaliste d’une génération d’autrefois. Ce que j’aime dans les portraits des écrivains par l’essayiste William Hazlitt, c’est le mélange de subjectivité et d’objectivité : d’une part le personnage pour ainsi dire tel qu’il fut, de l’autre le mythe que l’on s’en est fait et que l’on continue de se faire. Impossible de trancher.
*
Jean Piel et moi, nous commençâmes à nous voir autour d’un verre ; il m’interrogeait, il me provoquait intellectuellement, avec le plaisir évident d’un homme qui aimait passer du temps avec des femmes — c’était encore l’époque où les hommes ne craignaient pas d’être accusés de harcèlement sexuel s’ils faisaient un compliment aux femmes, et nous les femmes, nous savions très bien la limite entre une galanterie et un geste inapproprié. D’ailleurs, dans les compliments de ce fier Normand, il y avait toujours de quoi mitiger l’éloge : mes chaussures étaient trop plates, ou mes cheveux trop touffus, ou mon écharpe d’une couleur qu’il n’aimait pas.
*
Puis un jour, mon ami Antoine Compagnon me demanda d’écrire un article sur Barthes pour un numéro qu’il préparait : ce fut mon premier article dans Critique, « Contre le langage », en 1982, après la mort de Barthes. Piel était au courant, bien entendu ; il me dit que l’article n’était pas mal et, lorsque je lui fis remarquer que mon prénom italien avait été écrit avec un c— à vrai dire, peu m’importe ce cau lieu du z—, il me répondit : « Eh ! bon, alors ce sera C/Zau lieu de S/Z. »
*
Je travaillais déjà aux États-Unis ; les rencontres avec Piel se multipliaient lors de mes séjours et de mes semestres sabbatiques à Paris : parfois il me demandait un article dans l’urgence, défi que j’acceptais avec joie ; il me voulait italienne pour rendre compte de romans ou d’ouvrages d’architecture italiens. On déjeunait à l’une ou l’autre des Écluses, ou au Tiburce, rue du Dragon, joli restaurant tenu par des femmes : il se montrait tyrannique, les côtelettes d’agneau étaient meilleures la dernière fois, ma salade avait l’air gâtée, le vin n’était pas à son goût, le pain sec. Un jour, je lui parlais de Trieste, que je connais bien car je suis née dans une ville voisine, Udine (que Stendhal, hélas, en route vers Trieste, a traitée d’« antichambre de l’Allemagne »). Il eut l’air distrait, mais par la suite il publia un numéro sur Trieste — c’était l’époque des grands numéros géographiques de Critique… Moi, je buvais ses récits du passé, de sa vie, des gens qu’il avait connus, de quelques personnes de sa famille, comme son petit-fils Thomas qu’il adorait ; le plaisir de l’écouter avec son brio un peu méchant — car, il faut bien le dire, les bons sentiments sont « barbants », adjectif qu’il aimait à utiliser — compensait la terreur qu’il me faisait vivre lorsqu’il venait me chercher ou me reconduisait en voiture. Je ne sais pas comment j’ai survécu, ni comment il survivait en rentrant chez lui à Neuilly.
*

Un jour, ce fut le drame, Piel était furibond : on lui avait ôté le permis de conduire à cause de son âge. Quelle humiliation pour lui, mais quel soulagement pour moi ! Alors ce fut le temps des verres à six heures et demie — à l’époque on parlait ainsi, et non pas comme aujourd’hui avec des horaires ferroviaires — au Bar des Théâtres, avenue Montaigne ; je revois en pensée son expression de triomphe lorsque, ayant bavardé jusqu’à tard, il me proposait de rester dîner là avec lui et, si j’avais un rendez-vous pour le soir, que je descendais pour téléphoner et le décommander.
*
Je ne veux pas rappeler mes visites chez lui à Neuilly dans sa chambre de malade, mais faire justice de ma remarque sur ma peur en voiture avec lui : en 1986, je devais me préparer à passer un semestre à Los Angeles — quelle horreur, disait-il —, où il faudrait conduire. J’avais une Fiat Uno et j’avais dit à Piel qu’Antoine Compagnon, qui m’a appris à conduire, me faisait traverser la place de l’Étoile. Quelle épreuve ! En dépit de la difficulté qu’il eut à rentrer dans ma petite voiture avec sa canne, Piel prit sur lui de compléter mes cours de conduite, au-delà des Champs-Élysées, vers le Bois de Boulogne, et encore et encore autour de l’Arc-de-Triomphe. Il me grondait, et, coincé dans son siège de passager, sa terreur avec moi au volant était sans aucun doute supérieure à celle que j’avais éprouvée lorsque je montais dans sa voiture.
*
Je terminerai en m’arrêtant sur un objet qui n’a jamais cessé de m’étonner : son sac en cuir. Ce pauvre vieux sac toujours entrouvert, jeté par terre ou sur une banquette de café, était une sorte de boîte de Pandore à l’envers, car les merveilles qui en sortaient étaient… les manuscrits qu’il recevait et corrigeait : de vrais torchons, le papier froissé, les feuilles éparses, des tâches d’encre et de café, des trombones qui pendouillaient, des angles écornés, des phrases incompréhensibles qu’il ajoutait entre les lignes, des mots encerclés — un champ de combat, le combat qu’il menait pour publier Critique depuis 1962.
*
Voilà quelques éclats de souvenirs liés à ma passion pour la revue, et je voudrais dédier ces lignes à Philippe Roger qui, depuis 1996, dirige Critique à son tour et accomplit un travail formidable.
Patrizia Lombardo
Retrouvez l’ensemble du dossier ICI