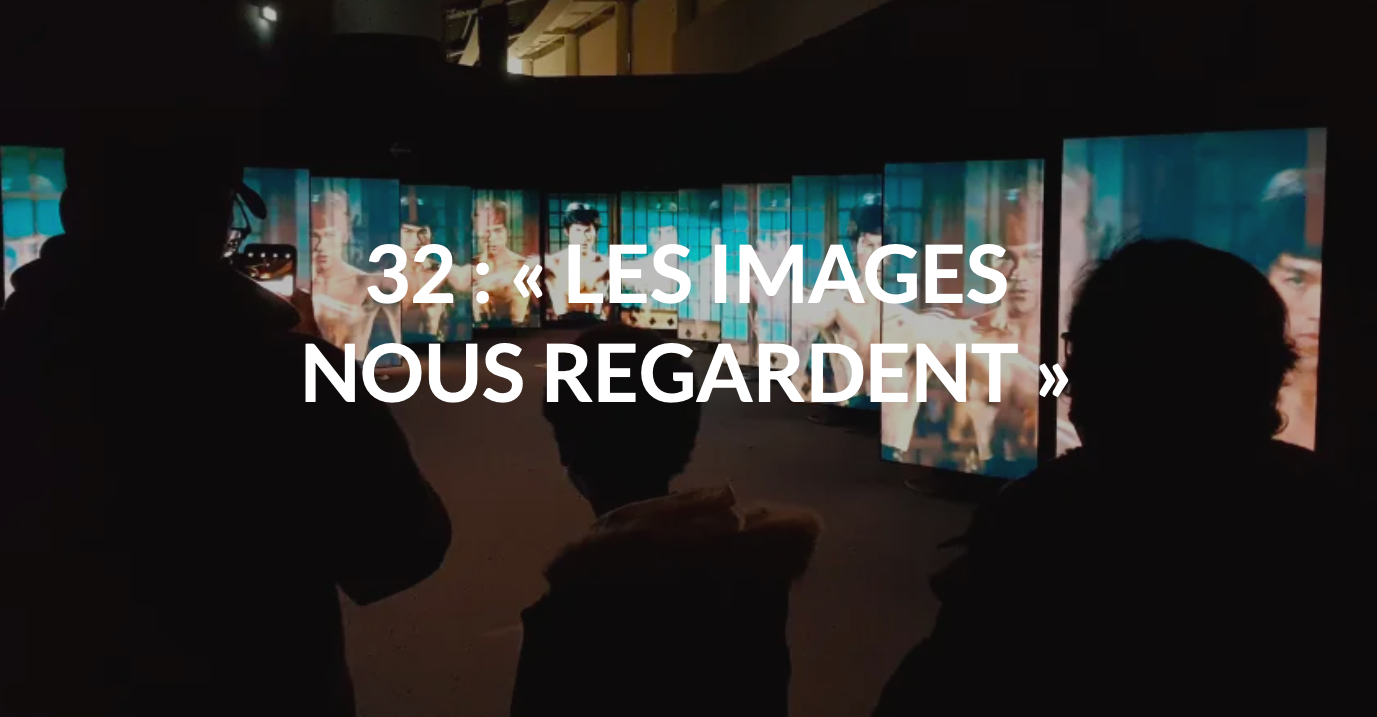Fondée par Laurent Albarracin, Guillaume Condello et Pierre Vinclair, la revue en ligne Catastrophes s’est arrêtée en juin 2025. Cinquante numéros d’une grande liberté, d’une inventivité et d’une diversité remarquables. C’est l’une des entreprises de revue les plus ambitieuses et généreuses de ces dix dernières années. Pierre Vinclair revient pour Ent’revues sur sa création, son histoire, son évolution,les idées et les choix qui la portent.
Catastrophes compte 50 numéros en ligne et 5 numéros papier publiés par le Corridor bleu (janvier 2026 pour le 5e et dernier). La revue fut mensuelle pendant deux ans de 2017 à 2019), puis bimestrielle 2019 à 2025 ; c’est la raison pour laquelle malgré huit ans d’existence, elle compte 50 numéros, alors que 8 n’est pas un multiple de 50 : 20 en deux ans, puis 30 en six ans. Au cours de ces huit années, Catastrophes a cumulé 318 000 vues de 99 000 visiteurs individuels. Elle a atteint le total de 1302 abonnés. 927 articles ou poèmes y ont été publiés, ainsi que 50 pdf de 80 pages de moyenne, en format paysage double-colonnes (entre 120 000 et 150 000 caractères espaces comprises pour chacun). 336 auteurs et autrices y ont été publiés, dans des textes provenant de 15 langues. L’auteur le plus jeune était Bastien Féry (né en 2001, par ailleurs l’un des animateurs de la revue Congre). L’auteur le plus vieux se perd dans la nuit des temps (en tout cas, les poèmes anonymes du Shijing furent écrits avant le 8e siècle avant JC). Ces éléments représentent tout ce qu’on peut dire d’objectif sur cette revue. Le reste relève du jugement rétrospectif et donc de l’interprétation, de la fierté ou du regret. N’étant pas historien de la littérature mais simple acteur, rien de ce qui suit n’est à prendre au pied de la lettre ; il s’agit plutôt d’un voyage dans ma tête.
Un collectif
Lorsque j’ai proposé à Laurent Albarracin (que j’avais rencontré par l’intermédiaire d’Ivar Ch’Vavar, et dont j’admirais l’élégance de l’écriture tant poétique que critique) et à Guillaume Condello (que je connaissais depuis plus de dix ans, et qui était sans doute le poète dont je me sentais le plus proche, humainement et poétiquement) de me rejoindre pour fonder la revue Catastrophes, je voulais à la fois aménager ma solitude et en sortir : d’un côté, je déménageais depuis Shanghai vers Singapour où ma femme avait été mutée, et souhaitais me donner avec cette revue (dont j’assurerais seul la mise en page, le secrétariat, le webmastering et la communication, partageant avec mes camarades uniquement la question éditoriale, c’est-à-dire la détermination du contenu de chaque numéro) une sorte de structure para-professionnelle, qui me retiendrait de tomber dans l’anomie en attendant de trouver un emploi ; d’un autre, je souhaitais rencontrer les poètes français de ma génération, travailler à leurs côtés, inventer avec eux la poésie contemporaine. Alors que nous étions un peu sortis de l’époque des blogs pour entrer dans celle des réseaux sociaux, j’avais l’impression que les revues de poésie n’avaient pas encore trouvé leur manière de s’implanter sur internet.
Celles que je connaissais en tout cas, Poezibao et Sitaudis, fonctionnaient surtout comme des recueils de recensions d’ouvrages, et accentuaient par leur organisation même (chacun était géré par une seule personne, Florence Trocmé et Pierre Le Pillouër) ce sentiment que la poésie était affaire d’individus : des individus publiaient des livres, sur lesquels d’autres individus rédigeaient des comptes rendus, que d’autres individus encore centralisaient et mettaient en ligne, sans doute à l’attention d’individus lecteurs disséminés derrière des écrans. Naïvement, je croyais au contraire que la création poétique était affaire de collectifs. Pour la France tout du moins : la Pléiade, les Romantiques, les Symbolistes, les Surréalistes… et bien souvent — en tout cas pour ce qui concernait les deux derniers siècles — des collectifs s’organisant autour de revues : le Parnasse contemporain, la Revue blanche, le Mercure de France, la NRF, la Révolution surréaliste, l’Ephémère, Java… J’avais moi-même, au tournant des années 2010, publié des poèmes dans MIR, Action poétique… Mais on ne comptait plus de « revue totale » en 2017 et depuis Singapour, il m’était impossible d’en lancer une autrement que sur internet.
Totale 2D
Par « revue totale », je veux dire une revue qui (tout en tenant certainement un style ou une manière de faire ; tout en travaillant des enjeux spécifiques — ancrée dans le particulier, donc, ou ne cédant pas à un œcuménisme de principe) se donne pour ambition (aussi prétentieuse, aussi démesurée soit celle-ci) de faire avancer « la poésie en général » et ce, en réalité, deux fois ou selon deux axes complémentaires — une revue « totale 2D » donc : d’un côté que (l’expression sent bon le hégélianisme automatique du XIXe siècle !) « l’esprit de l’époque » passe par elle, qu’elle soit « the place to be », ou encore qu’elle soit susceptible d’être liée à tout ce qui se fait d’intéressant et de signifiant ; mais aussi, d’un autre côté, qu’elle épuise les différents rapports que l’on peut avoir à la poésie ou les différentes manières dont la poésie se vit — qu’elle soit lieu de création, mais aussi de critique et de traduction. Action poétique et Java avaient très certainement été, de même que Po&sie, des revues du type « totale 2D » ; mais nous n’en connaissions aucune sur internet, lieu qui nous offrait qui plus est la possibilité de fédérer les poètes sur un mode différent que ce qu’avaient fait les revues papier par le passé.
Il n’est pas contestable que dans un pays tel que la France, il ne viendrait pas à l’idée de la plus grande proportion des gens de contribuer, et moins encore de s’abonner à une revue de poésie. On peut estimer qu’une revue de poésie se vend entre 300 et 500 exemplaires. Mettons 700, pour rendre hilare notre optimisme. Sur une population de 70 millions de personnes, cela fait un ratio de 1 exemplaire vendu pour 100 000 personnes. Si l’enjeu de la revue est de faire vivre un collectif, c’est-à-dire de permettre non à un, non à deux, non à trois, mais disons à une dizaine ou une vingtaine de poètes d’avancer dans leur art en s’entre-stimulant, on comprend que si l’on compte sur une entre-stimulation par canaux physiques, cela n’est possible en France qu’à Paris et alentours, où selon ce ratio d’1 à 100 000 on doit pouvoir regrouper jusqu’à rien de moins que 100 personnes (si l’on considère que l’agglomération compte 10 millions d’habitant). Mais cette opportunité offerte par Paris a un revers, que l’on pourrait appeler « l’illusion capitale » (en jouant sur les deux sens de « capitale »), dont nous a préservés la publication en ligne.
L’illusion capitale
Voici l’illusion capitale : celle de croire que « the place to be » est effectivement une place au sens géographique. Elle aboutit à imaginer que la littérature est une sorte de processus historique qui, ayant seulement lieu dans les plus grandes villes, épargne toutes les autres ; par conséquent, elle pousse à mépriser les productions littéraires qui ne viennent pas de la capitale même. La faute de raisonnement est majeure : si statistiquement la poésie n’intéresse qu’une personne sur 100 000 et donc une centaine de personnes à Paris, cela ne signifie certainement pas qu’il est impossible qu’elle intéresse une personne hors de Paris, même dans une ville de moins de 100 000 habitants ! Cette illusion capitale est très grave, non seulement pour les pauvres Provinciaux, a priori méprisés, mais pour la poésie même, parce qu’elle la transforme en une activité clanique ou tout du moins, un champ clos sur lui-même dont les sociologues ont bien raison de pointer du doigt l’entre-soi et de moquer les prétentions et les rituels de valorisation. Ce parisianisme aboutit aussi à un historicisme histrionique : dans ces quelques hectares où l’on prétend suivre de génération en génération les métamorphoses de la poésie, chaque époque renverse la précédente et en condamne les outils ; chaque sous-clan se persuade que l’histoire a un sens et prétend incarner la prochaine figure hégémonique de ce chamboule-tout.
Catastrophes, au contraire, était une revue plus que provinciale — complètement déterritorialisée, c’est-à-dire de partout et de nulle part, mondiale et atopique : Laurent habite dans un lieu-dit du Limousin, Guillaume était alors en banlieue parisienne, et moi à Singapour, puis à Londres, puis en Suisse. Nous avons publié des auteurs et des autrices vivant dans des mégapoles américaines autant que dans des trous perdus de France. L’illusion capitale était complètement brisée (même si nous avons toujours lancé à Paris nos numéros papier : il faut bien compter sur cette centaine de personnes assemblables en une audience physique !) Nous n’avons jamais rencontré la plupart des personnes que nous y avons publiées, ni n’avons jamais craint l’animosité qui aurait pu résulter d’un refus de manuscrit, puisqu’on ne risquait pas de les rencontrer. Bref, nous pouvions nous concentrer sur les textes, rien que les textes — comme si les poètes qui nous proposaient leur poème, leur traduction ou leur texte critique n’en étaient que les convoyeurs, et non pas des auteurs qu’il aurait fallu choyer ou tout du moins, dont il fallait ménager les encombrants égos. Et puis, nous n’étions qu’un blog gratuit, hébergé sur WordPress : une pauvre chose, vers laquelle on ne venait certainement pas si l’on recherchait honneurs et gratifications.
Littérature en fusion
L’aventure a duré huit ans, et sans aller évidemment jusqu’à dire qu’elle a changé quoi que ce soit au Schmilblick, elle a permis à des écrivains qui n’avaient jamais publié (parmi lesquels Julia Lepère, Guillaume Artous-Bouvet) d’être lus, mais aussi, parce qu’elle fonctionnait sur la base du feuilleton, à de véritables œuvres de naître, avant de trouver souvent une autre vie en livre, comme ce fut le cas de Lirisme d’Aurélie Foglia, d’A comme Babel de Guillaume Métayer (tous deux lauréats de prix importants), de Sophie ou la vie élastique d’Ariane Dreyfus, de Pastoral de Jean-Claude Pinson, du Manscrit d’Olivier Domerg et d’une multitude d’autres livres. En cela, Catastrophes n’a pas exactement fonctionné comme une revue papier à l’ancienne : il est évident que la publication à rythme soutenu (tous les mois, puis tous les deux mois), la possibilité de publier de grandes masses de texte (jusqu’à des épisodes de 100 000 signes), la quasi-instantanéité de la parution en ligne (moyennant quelques minutes de mise en page), la possibilité de continuer à corriger les textes même une fois publiés ou encore le fait que les lecteurs puissent commenter directement en-dessous de la page, fluidifiaient considérablement la publication pour la rapprocher du temps même de l’écriture. Une revue papier, du fait d’impératifs techniques incompressibles, reste une sorte de livre, avec son temps de fabrication et le saut vertigineux qui sépare l’amont privé de l’aval publié sur lequel on ne peut plus revenir ; une revue en ligne comme Catastrophes, au contraire, proposait quelque chose de beaucoup plus fluide qui permettait aux feuilletons d’être de véritables works in progress. De sorte que nous avions vraiment le sentiment de publier la création en train de se faire. Non pas des textes déjà refroidis par la force des choses.
En plus des auteurs invités, chaque numéro de Catastrophes comportait un dossier thématique, incluant une ou plusieurs cartes blanches, ainsi que trois rubriques pour lesquelles nous tournions, Laurent, Guillaume et moi : l’édito (présentant les enjeux généraux liés au thème du numéro), le Sentier critique (consistant en un compte rendu de plusieurs ouvrages en lien avec le dossier) et le Corps à corps (impliquant une sorte de dialogue problématique avec une œuvre de la tradition). Ces trois modalités d’intervention, la première plus théorique, la dernière plus pratique, ont joué pour nous le rôle de véritable laboratoire, et nous ont poussés à appréhender à des hauteurs variées et selon des angles toujours différents une cinquantaine d’objets, de tous ordres : la fin du vers libre (n°40), l’anarchie (n°47), le rapport aux images (n°32), Dante (n°30), les « objectivistes » (n°25), le cinéma (n°24), le rite (n°45), l’exil (n°31), les hétéronymes (n°39), Sexton et Plath (n°34), Pierre Alferi (n°42), l’avant-garde (n°48), etc. Autrement dit, Catastrophes nous a permis (nous a poussés) à étendre considérablement notre compréhension de la poésie — et pour ce qui me concerne, tous les essais que j’ai écrit depuis 2019 contiennent au moins un chapitre (et souvent bien davantage) dont le premier état se trouve en ligne sous la forme d’un édito, d’un sentier critique ou d’un corps à corps — jusqu’au point où nous avons eu le sentiment d’avoir fait le tour.
Épuisement
On comprend en effet aisément qu’après 50 numéros, nous avons eu le sentiment d’avoir en quelque sorte « épuisé » notre objet, en tout cas pour ce qui concerne les modalités à travers lesquelles on essayait de le saisir. De même qu’on avait le sentiment d’avoir « épuisé » notre génération, et d’avoir publié tous les auteurs français qui, à notre connaissance du moins (mais que les autres ne se sont-ils pas fait connaître !), étaient à la tête ou au commencement d’une œuvre qui nous semblait intéressante, et parfois, importante. Ce double-épuisement s’est fait d’autant mieux sentir qu’après quinze ans à l’étranger je suis pour ma part rentré à Paris, où je prends un plaisir naïf à m’abandonner de nouveau au charme de ce que j’ai appelé plus haut « l’illusion capitale » : Paris, avec ses librairies, ses théâtres, ses salles de concert, ses cinémas d’art et d’essais, ses bibliothèques ; avec la Sorbonne, l’EHESS, l’ENS ; Paris, où l’on peut avoir la chance de croiser des poètes, des universitaires, des revuistes et même parfois des membres d’Ent’revues qui vous passent commande d’un texte, peut faire croire au petit poète qui s’était habitué à l’absurdité de son art et à l’insignifiance de sa personne que le monde de l’esprit est partagé, qu’il est important, qu’il existe — qu’il est là ! C’est Paris ! Paris, le corps inorganique de l’esprit réalisé !
Qu’il ne s’y croie pas trop, le petit poète ! La réalité saura bien le rattraper. En attendant, permettez-lui de préciser que les lignes ci-dessus ne sont qu’un aperçu sommaire, aussi subjectif qu’allusif ; et qu’il y aurait beaucoup d’autres choses à dire, autant sur les enjeux auxquels la revue répondait que sur son mode de fonctionnement ou les raisons de son arrêt ; mais le n°5 de Catastrophes papier (Le Corridor bleu, 2026) essaie justement de s’en charger puisqu’il comprend un article de 100 000 (autant qu’il ne faut d’individus en ville pour débusquer un poète) signes intitulé « Addendum calamitatum ». Je me permets d’y renvoyer, tout en réservant cette ultime ligne pour remercier André Chabin de son invitation.
Pierre Vinclair