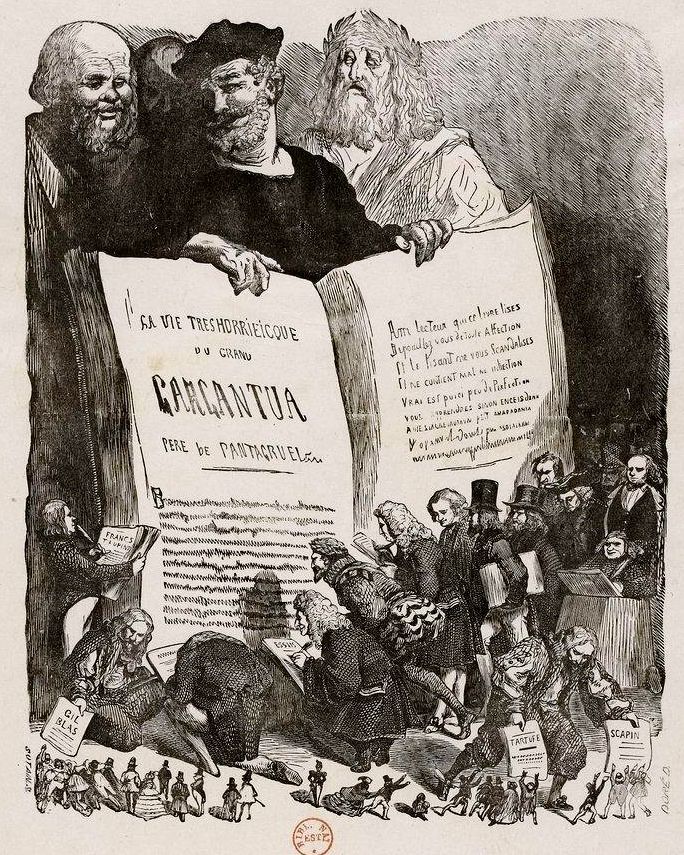Universitaire, diplomate, critique de cinéma et de littérature, romancier, poète, documentariste, jardinier à ses heures, Maurice Mourier a beaucoup écrit dans des revues – d’Esprit à La Quinzaine littéraire de Maurice Nadeau -, sur des films, des livres, des poètes : de Mizoguchi à François Villon, de Claude Simon à Jón Kalman Stefánsson…
Il écrit aujourd’hui régulièrement dans En attendant Nadeau qu’il a participé à fonder et dans Diasporiques où il publie un cycle critique de grande ampleur intitulé « Les Grands Transparents ». Autant passionné de Balzac, Breton, Verlaine ou Prévert, de Kurosawa, Fellini ou Jeanne Moreau, que d’astronomie, de sciences naturelles ou de paléontologie, il propose une approche singulière de la critique.
Ent’revues lui a proposé de partager, par son parcours en revues original, ses métiers, son cheminement intellectuel, de parler de son rapport critique, de la manière dont il l’envisage et le pratique. Il le résume en nous rappelant qu’être critique n’est pas un métier plus sot qu’un autre.
C’est à cette aventure personnelle, celle d’une critique qui frôle la fiction, écrite avec une grande liberté que nous vous convions en quatre épisodes.
Après être revenu sur un parcours académique qui admet sa cocasserie et réfléchit le geste critique en lui-même, au regard de Proust en particulier, Maurice Mourier s’essaie à penser la critique comme création.
Un brin de doctrine
Le danger de la critique comme création, quand on n’est pas Proust, est multiple. Premièrement, ça ne sert à rien, pas plus que la création elle-même, qui n’obéit qu’à des critères de beauté. Personne ne peut utiliser vraiment Bergotte (dont le portrait physique, d’ailleurs, correspondrait beaucoup mieux à Zola) pour se faire une opinion critique du Lys rouge ou de L’ïle des pingouins ou même de Petit Pierre dont pourtant les à côtés souterrains (comme j’ai tenté de le montrer dans mon « Grand Transparent » Proust – Diasporiques n° 32, janvier 2016) ont vraiment servi de matrice à l’invention de la mémoire involontaire.
Ensuite les dangers d’une critique création sont évidents dès l’instant où l’on définit la critique littéraire (légitimement) comme antidote contre tous les emballements interprétatifs (lectures politique, psychanalytique, mystique, simplement délirante) immensément favorisés par la pratique, inconsciente ou non, de l’anachronisme. Rien n’interdit de lire Le Livre des morts égyptien comme une anticipation des Evangiles, parce que rien n’interdit quelque lecture que ce soit, ou la première Eglogue de Virgile comme une prémonition de la naissance du Christ (nombre de latinistes emportés par leur foi catholique n’y ont pas manqué), mais enfin il s’agit bien là d’âneries historiques que des exégètes laborieux n’auront aucune peine à démonter.
Entre création et délire, la marge est en effet fort étroite et le souci lancinant de « remettre en contexte » n’est pas uniquement une préoccupation de vieux tousseux. Ce retour à la raison ne laisse pas, du reste, d’être douloureux et combien aimerions-nous mieux que Rabelais le magnifique fût un authentique libre-penseur et une sorte d’anarchiste ennemi des puissants, alors que l’étude attentive des textes montre combien son évangélisme était sincère et inconditionnelle sa dévotion à l’égard de François Ier, humaniste seulement si l’on a en vue l’art et la culture mais pas du tout dans le domaine, largement anachronique, de ce que l’on appellera un jour les droits de l’homme.
Semblablement, comme disait Villon, mais à l’inverse, la lecture académique lénifiante de La Fontaine (et pas seulement académique puisqu’elle a aveuglé Aragon et à son malheureux exemple les surréalistes) ne saurait résister à l’analyse serrée des fables d’un des adversaires les plus conscients et constants de la monarchie absolue, qui fut aussi un prodigieux inventeur de formes.
Pour une critique fiction
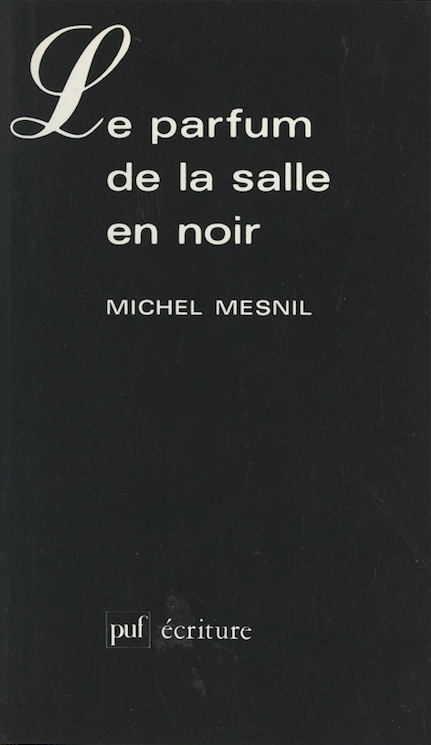
La très longue fréquentation du cinéma, et de la salle de cinéma, lieu de fantasmes si importants pour moi que je lui ai consacré un livre (Le Parfum de la salle en noir, PUF 1985, sous pseudo Michel Mesnil) m’a beaucoup appris. J’ai constaté que je pouvais me passionner pour des auteurs d’esthétiques très différentes, de Fritz Lang et Hitchcock (si proches) à Bergman et Fellini (si opposés), de Keaton à Ozu, d’Ophuls à Duras, de Godard à Mizoguchi, de Kaurismaki à Bela Tarr. Cela ne m’a pas du tout poussé à me construire une théorie blindée du 7e Art, mais au contraire à admirer, sans préjugé d’école, du moins je l’espère, tout ce qui, du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, avec une prédilection fidèle pour l’animation, des frères Fleischer à Disney, de Paul Grimault au studio Gibli, convenait à ma propre sensibilité. Et puis un jour, sans crier gare, un déclic à l’étiologie pour moi inconnue a fait que le cinéma m’a chu des yeux et que je n’ai plus fréquenté les salles, sauf très exceptionnellement, pour la ressortie de Lola Montès (occasion de mon dernier et sans doute moins sommaire article dans Esprit (février 2010), ou pour Le Cheval de Turin.
J’ai pris à cette errance une aversion toute particulière à l’égard des positions bétonnées parce que communément partagées, qui ont transformé, ici et là, parfois durant des années, telle officine critique en lieu de terrorisme et d’excommunication. Hystérie qui ne peut à la rigueur s’excuser que si elle se transforme en jeu conscient, mais qui a revêtu le plus souvent une raideur toute cléricale ou stalinienne. Du côté gauche, tantôt par incapacité à lire l’image de cinéma, cela aboutit, chez les surréalistes, à dénigrer Cocteau (toute la meute) et à encenser bêtement n’importe quelle toile ressortissant au dogme de l’amour fou (Ado Kyrou, exemple type).
Tantôt, plus gravement (Sadoul, la voix de son maître Kanapa) à déclarer suspect le Bunuel anar du Chien andalou (où Dali a la plus grande part), à mépriser Disney comme homo déguisé et à célébrer le réalisme socialiste le plus plat et le plus hypocrite.
Du côté droit, on défendra l’académisme gluant des Delannoy, Decoin et consorts, tout en restant aveugle au nationalisme grand-russe du premier Tarkovski.
Transformer en jeu conscient une position critique peu conforme à l’esprit de sérieux et à l’honnêteté historique, voilà peut-être la seule issue pour qui veut éviter et la trop fréquente lourdeur universitaire (par crainte d’ennuyer, surtout quand on a subi soi-même des années d’enseignement majoritairement chiantissime), et le totémisme bestial de ceux qui ont une fois pour toutes plié le genou devant la VÉRITÉ rabâchée, autre nom du mensonge.
Il me semble donc qu’on peut opter pour une critique, notamment littéraire, qui s’ouvre grandes les portes de l’invention fictionnelle, mais à la condition expresse de la présenter au lecteur comme suffisamment reconnaissable en tant que fiction. Ne cherche pas chez moi, lecteur, ou pas seulement, une étude solide et charpentée de telle œuvre canonique (ou pas), de tel auteur adulé (ou méconnu). Cela, la parfaite (ou plutôt la plus parfaite possible à ce jour) analyse sur Balzac ou Jarry ou Marie de France, tu le trouveras dans la dernière édition justement nommée critique élaborée par le ou la spécialiste de la chose – il en est non seulement de fiables mais d’excellents, et qui écrivent vraiment bien, en sus.
Moi, ce que je peux t’offrir, afin d’exciter tes méninges – éventuellement contre moi, mes propres préjugés, mes insuffisances – et si possible de te divertir dans « le deuil qui te mine et consomme », c’est, eh bien ! du diable si je sais ce que c’est !
Maurice Mourier
À suivre…
Lire l’épisode I
Lire l’épisode II
Lire l’épisode IV
Derniers ouvrages parus :
Behr le Bugnon, PhB éditions, 2020
Par une forêt obscure, L’Ogre, 2016
Dans la maison qui recule, L’Ogre, 2015