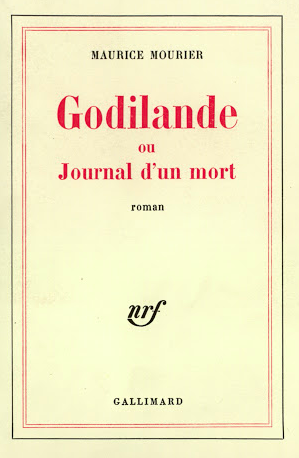Universitaire, diplomate, critique de cinéma et de littérature, romancier, poète, documentariste, jardinier à ses heures, Maurice Mourier a beaucoup écrit dans des revues – d’Esprit à La Quinzaine littéraire de Maurice Nadeau -, sur des films, des livres, des poètes : de Mizoguchi à François Villon, de Claude Simon à Jón Kalman Stefánsson…
Il écrit aujourd’hui régulièrement dans En attendant Nadeau qu’il a participé à fonder et dans Diasporiques où il publie un cycle critique de grande ampleur intitulé « Les Grands Transparents ». Autant passionné de Balzac, Breton, Verlaine ou Prévert, de Kurosawa, Fellini ou Jeanne Moreau, que d’astronomie, de sciences naturelles ou de paléontologie, il propose une approche singulière de la critique.
Ent’revues lui a proposé de partager, par son parcours en revues original, ses métiers, son cheminement intellectuel, de parler de son rapport critique, de la manière dont il l’envisage et le pratique. Il le résume en nous rappelant qu’être critique n’est pas un métier plus sot qu’un autre.
C’est à cette aventure personnelle, celle d’une critique qui frôle la fiction, écrite avec une grande liberté que nous vous convions en quatre épisodes.
Après avoir déployé une réflexion sur la critique et plaidé pour une manière de l’aborder qui admet sa dimension créative et fictionnelle, Maurice Mourier revient sur deux de ses aventures majeures en revues : La Quinzaine littéraire de Maurice Nadeau et son important chantier des « Grands Transparents » qui paraît en épisodes dans Diasporiques. Un véritable éloge de l’éclectisme.
Le projet des « Grands Transparents »
En tout cas l’envie d’essayer ce qui pour moi était du nouveau – après des décennies de publications sinon sages du moins compatibles avec ce qui est généralement admis, dans les revues, comme utile en fait d’article de critique littéraire – obéit aussi aux lois fantasques du hasard.
Mais je sais au moins à peu près comment c’est advenu, à la suite d’une série de hasards s’étalant sur trente et une années, de 1963 à 1994. Hasards qui tout ont abouti à des amitiés. Amitiés qui ont toutes débouché sur du nouveau.
Résumons au galop. En 1963, arrivés au Japon, Pascaline et moi nouons, en marge des travaux d’ambassade (peu affriolante, une ambassade, sauf exception : nous nous y ferons, du Conseiller culturel, mon « patron », un ami comme on dit « pour la vie »), une amitié solide tant avec Auguste Anglès, brillant universitaire qui alors, et depuis plus de vingt ans, trimballe le tentaculaire dossier portant sur les débuts de La Nouvelle Revue Française, qui deviendra enfin une thèse magistrale soutenue peu avant la mort de son auteur, qu’avec Maurice Pinguet, lui aussi disparu après avoir produit une oeuvre unique et géniale, La Mort volontaire au Japon.
C’est Maurice (Pinguet) qui, changeant de quartier à Tôkyô, nous laisse sa merveilleuse petite maison traditionnelle et, « en héritage », un lumineux vagabond, Théo Lesoualc’h, mime, photographe, poète qui, dépourvu de domicile fixe, loge de loin en loin chez lui. Devenu à son tour notre intime, il rentre avec nous à Paris et, tout en participant au Théâtre panique d’Arrabal, publie son premier roman vertige, La Vie vite, chez Maurice Nadeau, dont le nom est inconnu de moi mais pas de Pascaline qui, travaillant de son côté à sa future thèse sur le surréalisme et la fin de siècle, sait tout du surréalisme.
Quittant Paris qu’il a pris en grippe (vers 1971, les suites de 68 l’ont déçu), Théo s’installe pour cinq ans chez nous dans les Cévennes et, au cours de ses activités de poète, collabore à la revue Vrac publiée par un éditeur fantasque, Samuel Tastet, qu’il nous fait connaître (vers les années 80) et qui devient lui aussi un ami à éclipses mais très cher.
Dix ans plus tard Samuel (Tastet) , résidant alors en Roumanie dont il a appris la langue, se trouve être en rapport d’affaires conflictuel mais courtois avec Maurice Nadeau qui va publier une anthologie de l’avant-garde poétique roumaine. Lors d’un de ses passages en coup de vent à Paris, il me dit (je ne sais toujours pas pourquoi) : tu devrais écrire dans La Quinzaine littéraire de Nadeau, je vais te présenter. Ce qu’il fait et Nadeau m’accueille chaleureusement : « C’est vous l’écrivain ? » Il est bien le seul à se souvenir qu’au début des années 70 j’ai publié chez Gallimard deux romans.
S’ensuit, cependant que Samuel publie dans sa propre maison (EST-Samuel Tastet, qui aujourd’hui fonctionne toujours), deux romans de moi (en 2006 puis 2009), une collaboration à La Quinzaine qui va durer jusqu’à la mort de Nadeau, puis jusqu’à la fin du titre animé par le triumvirat Tiphaine Samoyault-Pierre Pachet-Jean Lacoste.
J’y donne 275 articles (sauf erreur ou omission). Années fécondes où je ne manque pas une seule des réunions du mercredi en face de Beaubourg et peaufine peut-être, sans trop en être conscient, ce qui semble devoir devenir ma « méthode ». Ce n’est pas Nadeau qui me l’a apprise, encore moins imposée, son respect de l’écriture d’autrui étant d’une qualité à nulle autre pareille. D’ailleurs, à cette époque, qui, précède de peu mon départ en retraite (mon premier « papier », sur Nono, un roman de Rachilde, date de juin 1994), j’ai déjà longuement pensé, modifié, assoupli le concept -si c’en est un, Deleuze ne le cautionnerait pas – de « lecture approfondie ».
Mais il est sûr que le compagnonnage de tant de gens intelligents et sensibles (ceux du « Comité »), par son exigence et surtout, surtout son ouverture sans exclusive vers toutes les formes de littérature française et étrangère, ancienne ou moderne, pourvu qu’elle présente un accent d’authenticité qui ne soit pas imitable, offre une occasion unique de devenir ce que l’on est .
Et puis il y a le maître de céans, bienveillant et sévère (j’ai eu de la veine, il ne m’a jamais refusé un papier, et m’a prié une seule fois, en s’excusant, d’en retirer un, qui chagrinait Anne Sarraute car il descendait le roman d’une de ses copines journalistes), indiscutablement maître avant le Dieu absent de son Panthéon personnel, d’une sensibilité et d’une affectivité qu’il dissimulait de son mieux, trônant la sonnette à la main afin qu’on ne dépassât pas trop les 60 minutes de la réunion.
Nadeau, le remarquable écrivain, le lecteur incomparable, susceptible de lancer de belles vacheries verbales mais bien plus doué pour les attachements passionnés à une œuvre, à un être. Bon sang ! Il faut le répéter : nous, les soutiers du Comité, rangés comme des enfants respectueux autour de lui et d’Anne, à côté de Bertrand Leclair), comme dit Ettore Scola : « C’Eramo Tanto Amati ».
Le projet ultérieur (ultime ?) des « Grands Transparents »
En tout cas, après l’expérience essentielle de La Quinzaine littéraire , puis parallèlement à celle-ci qui se poursuit toujours, sur nouveaux frais sous la houlette de Tiphaine (Samoyault) et de Jean (Lacoste), « en ligne » dans En attendant Nadeau, l’envie de poursuivre ce qui était pour moi du nouveau – après des décennies de publications presque toutes sinon sages, du moins compatibles avec ce qui est généralement admis, dans les revues, comme norme en fait d’article de critique littéraire, cette envie demeure intacte et continue d’obéir aux lois primesautières du hasard (objectif, bien entendu). Si Diasporiques, fondé et dirigé par mon ami d’enfance Philippe Lazar, n’était pas un périodique intellectuel atypique parce que particulièrement généraliste (politique, économique, historique mais aussi artistique, littéraire, très ouvert sur les questions européennes et les diasporas internationales), je n’aurais certainement pas été tenté d’y lancer une série d’essais critiques sur des auteurs, aussi ouvertement autarcique, à partir d’une rêverie autour d’André Breton.
C’est chez lui, en effet, auquel, vu ma crasse ignorance initiale, je n’avais été initié que sur le tard par Pascaline Mourier-Casile, de longtemps adepte, que je suis tombé par hasard (cet acteur central de nos vies, de la mienne en tout cas) sur un échange qu’il avait eu aux Etats-Unis à la fin de son exil avec le peintre Matta, inventeur des « Grands Transparents ». Dans le contexte du vif intérêt de Breton pour l’ésotérisme, l’alchimie, l’invisible, il s’agit d’entités flottant autour de nous et qui, d’une certaine façon, influencent nos destinées. Depuis l’enfance, les personnages de mes lectures se sont toujours imposés à moi, et par leur truchement les écrivains dont ces personnages sont les créatures, à la manière de compagnons dépourvus de corps mais souvent bien plus vivants que les vivants. Je me suis donc en quelque sorte approprié le concept de « Grands Transparents » et, après avoir lu en profondeur le tableau de Max Ernst Au rendez-vous des amis (premier article de la série, Diasporiques n° 12, décembre 2010) comme une évocation chamanique de Breton, son groupe et quelques-uns de leurs phares, j’ai eu l’ambition de faire revivre, en toute liberté d’interprétation de leurs vies et de leurs œuvres ceux de mes propres amis écrivains qui, morts depuis longtemps, me hantent néanmoins, me tiennent compagnie sans trêve, me font entendre leurs voix, chacune de ces assertions ne constituant pas des images plus ou moins pertinentes des rapports que tout bon lecteur entretient avec la littérature, mais bien pour moi les traductions les plus réalistes et objectives de ce compagnonnage plus charnel que cérébral.
Mes efforts parfois vains pour retrouver la présence quasi physique de ces êtres de papier, voilà qui fait toute la matière des « Grands Transparents », aboutissement actuel (après les 21 élus de la première série, j’en suis au 5e de la seconde) de ma critique fiction, qui doit évidemment beaucoup aux dizaines de pages que j’ai pu écrire antérieurement à propos de tel ou tel, mais prétend s’affranchir de cet héritage parfois encombrant, par exemple en se lançant sans filet, comme Lola Montès au terme du chef-d’œuvre d’Ophuls, dans le bain d’une improvisation à haut risque sur un auteur dont je n’ai jamais rien écrit. Ainsi du tout dernier Transparent, Homère, dont je me suis fait une joie un peu iconoclaste de ne relire que l’Odyssée, et dans une traduction (celle de Victor Bérard, celle de mon enfance) bien dépassée, sans m’appuyer sur les (magnifiques) travaux érudits les plus récents.
Mais je mijote ma tambouille à la loyale, en annonçant la couleur : ceci n’est pas une pipe, même reconstituée péniblement en ajustant des débris de fouilles, c’est un jeu littéraire, une fiction. Si elle contient aussi quelque aperçu sur une vérité historique possible, tant mieux, mais ce n’est pas le but que j’ai poursuivi.
Éloge de l’éclectisme

Une ultime verge pour me faire battre. La Fontaine, un de mes Transparents les plus précieux, l’indique clairement : « j’en lis qui sont du nord et qui sont du midi ». Quant à la méthode, il s’en tire par une pirouette : « diversité c’est ma devise ». Sur ces deux points j’acquiesce en disciple courbé sous le génie du maître. Si le Covid avide me permet de prolonger encore un peu la seconde série des Transparents, je continuerai donc à y batifoler. Quelle tristesse qu’une prairie jonchée de fleurs monocolores ! N’ayant aucune doctrine précise à défendre, puisque je m’efforce de fuir comme la peste les a priori, je revendique hautement le droit d’affirmer que Claudel ne saurait être un Transparent pour personne, car ce n’est qu’un poète lauréat aussi ennuyeux que Tennyson, tout en accueillant comme mien le Transparent Péguy, vieux barde fraternel des Cinq prières dans la cathédrale de Chartres, ce lamento répétitif splendide, à la Phil Glass. D’un côté un chien de faïence, de l’autre un vrai chien, de l’espèce à la truffe humide et à l’amitié secourable, qui m’accompagne depuis la prime adolescence. Et pourtant ils furent tous deux des muezzin du dieu absent, allez comprendre !
Maurice Mourier
Derniers ouvrages parus :
Behr le Bugnon, PhB éditions, 2020
Par une forêt obscure, L’Ogre, 2016
Dans la maison qui recule, L’Ogre, 2015