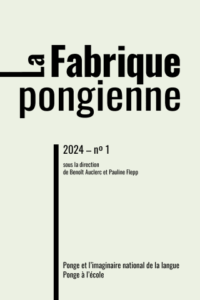
La Fabrique pongienne, c’est un peu le parti pris des gloses, si on veut bien nous autoriser ce clin d’œil au fameux recueil de 1942, Le Parti pris des choses. Exigeante mais stimulante pour qui s’intéresse à l’œuvre de Francis Ponge (1899-1988), cette revue électronique – au contenu en libre accès – se situe complètement dans la continuité des Cahiers Francis Ponge, hébergés plusieurs années durant par les éditions Garnier. Pour être précis, le support en ligne prend d’ailleurs la suite de cette parution papier, fidèle à l’engagement de sa devancière de toujours mieux approfondir la connaissance du corpus existant mais aussi, grâce à l’apport d’Armande Ponge, la fille de l’auteur, de donner à lire des archives inédites. Bref, entre réflexions, recensions et référencements, la revue creuse bel et bien la parcelle et le terreau pongien. Notre survol synthétique ici voudrait suivre quelques-uns de ces sillons.
Nourri principalement des travaux de tout un pool d’universitaires parmi les plus avertis de l’entreprise pongienne, le tout premier numéro de La Fabrique, daté de 2024 (son rythme de publication est annuel), navigue entre études de texte précises et démarches de contextualisation précieuses. Deux façons différentes, qui s’enrichissent l’une l’autre, d’assurer à l’œuvre de Ponge un ancrage solide dans l’histoire littéraire. Faisant fond sur des contributions de Marie Frisson et Aziz Jendari, une première partie se penche ainsi sur l’articulation entre Ponge et l’école. Car l’œuvre est de plus en plus étudiée, ce qui concourt évidemment à sa patrimonialisation, et les élèves, non sans mal parfois, en apprivoisent toute la singularité créative, entre tradition et renouveau. Comme le disent Benoît Auclerc, Pauline Fleppe et Luigi Magno dans leur présentation, « la rencontre de Ponge avec l’institution scolaire relève donc à la fois d’une évidence et d’une incongruité. »
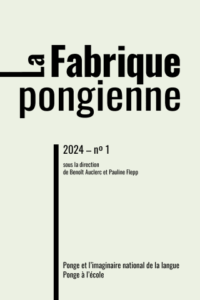 Dans une autre section de la revue, deux autres articles, l’un signé Vincent Berthelier, l’autre proposé par Lucas Kervegan, questionnent « l’imaginaire national de la langue ». Ici c’est plutôt la poétique au prisme du tempérament politique de Ponge qui fait l’objet d’une réflexion, et ce à travers la relecture attentive de Pour un Malherbe, L’Écrit Beaubourg et Nous, mots français. En quoi son cheminement, du communisme au gaullisme, infléchit-il ou reflète-t-il ce que Ponge est/fait, c’est-à-dire aussi bien sa position d’écrivain que la portée de son travail sur et avec la langue : c’est, vite dit, sur cette toile de fond idéologique que s’inscrivent ces deux textes-là, sans désamorcer jamais, au contraire, la teneur parfois polémique du débat qu’une telle approche suscite encore et toujours dans son sillage. D’une certaine manière, on retrouve aussi ce thème de l’enjeu politique au cœur du dire littéraire dans le compte-rendu de lecture que fait Bénédicte Gorrillot d’un ouvrage consacré à la correspondance croisée (1969-1986) entre Francis Ponge et Christian Prigent.
Dans une autre section de la revue, deux autres articles, l’un signé Vincent Berthelier, l’autre proposé par Lucas Kervegan, questionnent « l’imaginaire national de la langue ». Ici c’est plutôt la poétique au prisme du tempérament politique de Ponge qui fait l’objet d’une réflexion, et ce à travers la relecture attentive de Pour un Malherbe, L’Écrit Beaubourg et Nous, mots français. En quoi son cheminement, du communisme au gaullisme, infléchit-il ou reflète-t-il ce que Ponge est/fait, c’est-à-dire aussi bien sa position d’écrivain que la portée de son travail sur et avec la langue : c’est, vite dit, sur cette toile de fond idéologique que s’inscrivent ces deux textes-là, sans désamorcer jamais, au contraire, la teneur parfois polémique du débat qu’une telle approche suscite encore et toujours dans son sillage. D’une certaine manière, on retrouve aussi ce thème de l’enjeu politique au cœur du dire littéraire dans le compte-rendu de lecture que fait Bénédicte Gorrillot d’un ouvrage consacré à la correspondance croisée (1969-1986) entre Francis Ponge et Christian Prigent.
La Fabrique pongienne propose également des entretiens qui éclairent de façon peut-être plus oblique mais pas moins passionnante, la figure de Ponge et son œuvre. Et des généalogies, plus ou moins nettes, que l’une et l’autre ont suscitées. Dans cette livraison, c’est par exemple le cas, entre autres rencontres, d’un échange avec le poète et écrivain-voyageur Gérard Macé. Francis Ponge « a fait partie de mon roman d’apprentissage », confie-t-il, sa lecture relevant de ce qu’il estime être, avec le recul, « de l’ordre de la salubrité ». Entre lui et son aîné, qu’il rencontre la première fois en 1969, il y a peut-être moins filiation qu’imprégnation : « Je me distingue de Francis Ponge, parce que je suis un mauvais disciple. Je veux dire par là que mes admirations, mes intérêts, mes fréquentations n’ont jamais fait de moi un suiveur. Je n’ai pas écrit pour imiter, ou alors c’est à mon insu. D’ailleurs, il me semble que la lecture de Ponge encourage à inventer sa propre voie », dit joliment et justement Gérard Macé en réponse à la question d’une possible influence. On pourrait finalement détourner quelque peu cette dernière remarque et dire de La Fabrique pongienne qu’au fond, elle encourage à entendre la voix propre de Ponge. Et ses échos et résonnances ailleurs.
Anthony Dufraisse
Retrouvez les précédentes chroniques
« Au Rendez-vous des amis »
